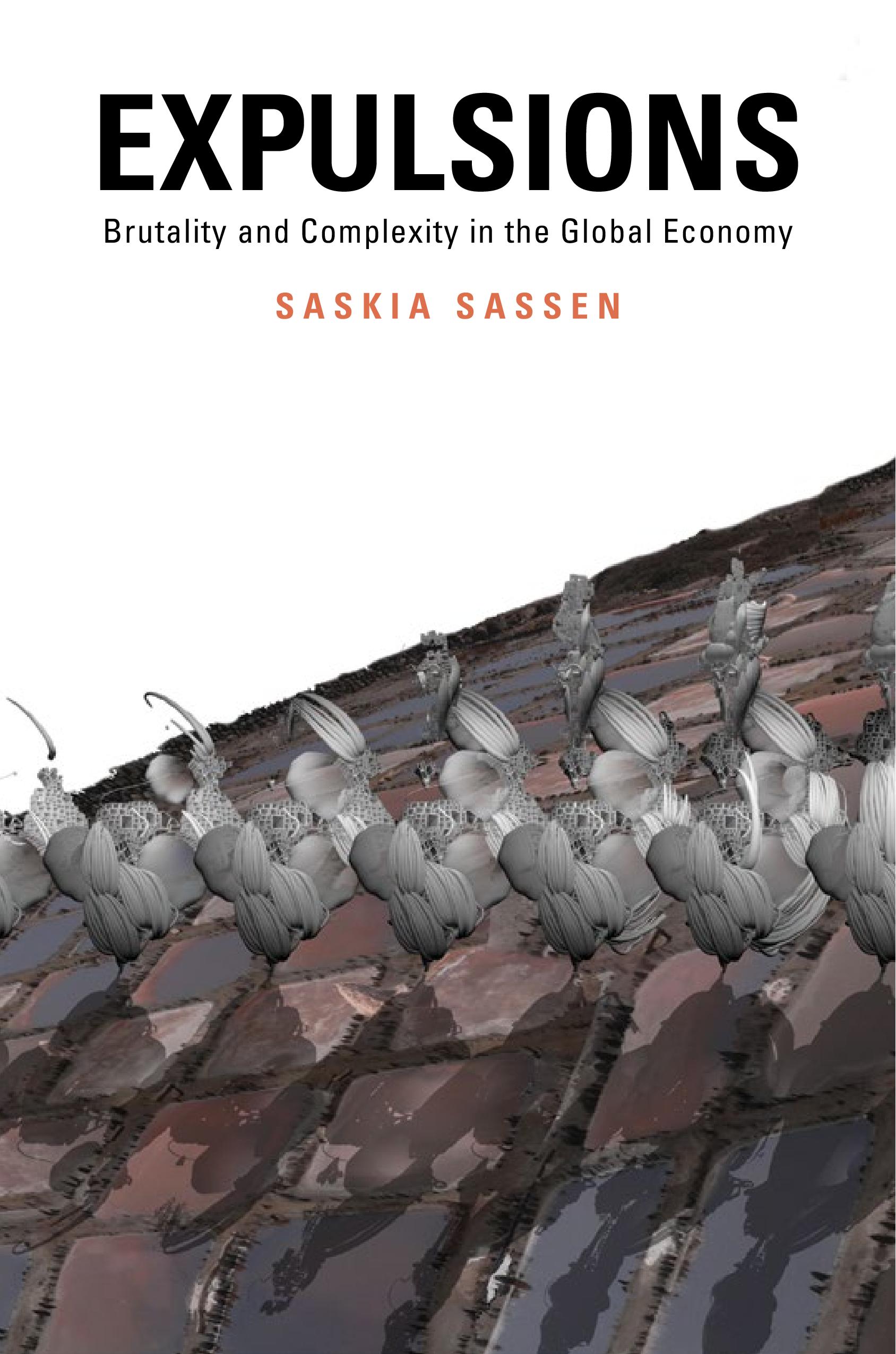
Saskia Sassen
Expulsions. Brutality and complexity in the global economy
Cambridge (Massachussets) and London The Belknap Press of Harvard University Press, 298p. | commenté par : Matthieu Giroud
Avec cet ouvrage Saskia Sassen poursuit son entreprise d’analyse critique des mécanismes et des « pathologies du capitalisme global contemporain » (p1). La sociologue s’attaque ici, avec ambition, aux nouvelles logiques d’expulsion qui caractérisent une économie mondiale dont le fonctionnement est désormais complètement dicté par les principes d’un capitalisme avancé c’est-à-dire financier. Selon elle, le « rétrécissement » entamé dès les années 1980 de l’espace des économies nationales, à grands coups de privatisations, de dérégulations, d’ouvertures sélective des frontières, est à l’origine de dynamiques de plus en plus rapides et brutales qui évincent des individus, des entreprises et des lieux toujours plus nombreux, des différents systèmes – économiques, sociaux ou biosphériques – qui ordonnent les sociétés mondialisées contemporaines.
L’ « expulsion » est donc appréhendée ici dans un sens extrêmement large, ce qui peut parfois la rendre difficile à saisir concrètement. Il peut s’agir autant de personnes n’ayant plus accès à l’emploi, aux services médicaux, ayant été incarcérées ou expulsées de leurs terres ou de leur logement acheté grâce à des prêts bancaires nocifs, que de petites entreprises dépossédées par des grandes firmes internationales, ou encore d’éléments naturels souillés, extraits tout bonnement du fonctionnement de la biosphère, comme c’est le cas avec les 400 zones océaniques mortes identifiées à l’échelle du globe et réparties sur plus de 245 000 km2. Ces formes d’expulsion ne seraient désormais plus compensées par des mécanismes d’inclusion et d’incorporation, comme cela a pu être le cas au moment où les principes keynésiens tentaient de réguler, certes au nom de la production et de la consommation de masse, un capitalisme plus industriel et commercial que financier. Les expulsions contemporaines se différencient aussi de celles qui ont accompagné les transformations successives du capitalisme jusqu’aux années 1980 par leur ampleur (scaling) puisqu’elles n’épargnent dorénavant aucun pays du globe et peuvent affecter des territoires extrêmement vastes (telle une ville entière comme Detroit ou la quasi totalité d’un territoire national comme celui de la Somalie). Pour Saskia Sassen, ces expulsions correspondent en fait aux « saillances de dynamiques plus complexes et difficilement saisissables » (p. 216). Et c’est bien ici que se situe toute la thèse de l’auteur mais aussi l’intérêt de sa démarche. La diversité, parfois foisonnante, de ces formes d’expulsion, que ce soit à travers les groupes sociaux, les lieux, les pays, cache finalement un nombre assez restreint de dynamiques « souterraines », invisibles mais extrêmement structurantes.
L’ambition est donc ici totalisante puisqu’il s’agit de redonner du sens à cette multitude et à ce foisonnement de surface en dévoilant le système de dynamiques finalement assez basiques qui en est à l’origine, et donc à recréer des liens, effectuer des connections là où de prime abord il semble ne pas pouvoir en avoir. Ces dynamiques, parmi lesquelles on trouve la multiplication à l’échelle mondiale de « zones extrêmes pour les opérations économiques clés » (p.9), la part croissante du rôle de la finance (définie par l’auteur comme « l’action de vendre quelque chose que l’on ne détient pas ») au sein du réseau des villes globales, le développement technologique, mais aussi la quête éperdue de profit ou encore l’indifférence à l’égard de l’environnement, sont à la source de ce que Saskia Sassen appelle des « formations prédatrices », responsables des expulsions ou des inclusions forcées au capital. Ces formations sont bien plus que des coalitions d’acteurs, mais des assemblages d’individus puissants, de marchés, de technologies, de firmes et d’instances publiques qui se caractérisent par leur complexité organisationnelle et fonctionnelle ainsi que par l’opacité de leur gouvernance, ce qui les rend insaisissables et donc incontrôlables. D’après Saskia Sassen, leur pouvoir de destruction et d’expulsion, leur « brutalité élémentaire », tient essentiellement de cette « complexité » qui est aussi celle des instruments, notamment financiers, utilisés et qui nécessitent la maitrise d’un savoir extrêmement pointu, spécialisé et de fait discriminant. De tels instruments produits par « de brillantes classes créatives et des formules mathématiques avancées » sont ainsi accusés d’être responsables de « l’expulsion quelques années seulement après leur création de plusieurs millions de personnes » (p. 2). Pour pouvoir identifier ces forces « souterraines » et rapprocher entre elles des formes d’expulsion apparemment distantes et distinctes, Saskia Sassen enjoint à un travail de remise en cause profonde (recoding) de nos concepts et outils d’analyse : « Face à des dynamiques contemporaines comme la croissance des inégalités et de la pauvreté, l’augmentation de la dette gouvernementale, etc., les outils d’analyse dont on dispose sont dépassés. On tombe en effet trop rapidement dans des explications classiques insistant tantôt sur l’irresponsabilité fiscale des gouvernements, sur celle de ménages incapables de rembourser leurs dettes, sur le trop-plein de régulation. Ces explications ont sans doute encore leur part de vérité, mais il est préférable d’explorer si d’autres dynamiques sont à l’œuvre ; des dynamiques sous-terraines qui transgressent les frontières conceptuelles et historiques traditionnelles et remettent en cause les façons dont on analyse nos économies et nos sociétés » (p.8). De telles frontières sont par exemple celles qui distinguent le Nord du Sud, l’Est de l’Ouest, le capitalisme du communisme, le rural de l’urbain, etc.
Pour détecter ces dynamiques souterraines destructrices, mettre en lumière les formations prédatrices qui les produisent et justifier l’exigence de « recoder » nos catégories de pensée pour pouvoir les appréhender, Saskia Sassen appuie sa démonstration sur une grande variété d’études de cas qu’elle regroupe dans quatre chapitres dits « empiriques ». Chacun de ces chapitres aborde des situations et des formes d’expulsion qualifiées « d’extrêmes » ; l’hypothèse étant que ce qui est périphérique (« at the systemic edge » (p. 212)) aujourd’hui se généralisera demain. Le chapitre 1 (Shrinking economies, growing expulsions) reprend les grandes tendances qui ont marqué le capitalisme depuis les années 1980. La dépendance croissante des économies nationales à l’égard des forces du marché global conduit à leur contraction et à la mise en œuvre de mesures d’austérité redoutables pour les populations. Les conséquences sont connues : croissance des inégalités entre les groupes sociaux, augmentation de la pauvreté, concentration des richesses, aggravation des destructions environnementales et donc accroissement des formes d’expulsion des individus non pas uniquement des économies locales, mais plus globalement de leurs « espaces de vie ». C’est ainsi que l’auteur interprète par exemple la faillite de nombreux entrepreneurs, le chômage galopant, l’émigration massive, l’augmentation du nombre de suicides ou encore la multiplication des saisies immobilières dans des pays comme la Grèce, le Portugal ou l’Espagne ; mais aussi la massification et la diversification des formes d’incarcération aux Etats-Unis, qui au passage participe au développement florissant d’une économie de la sécurité. Le chapitre 2 (The new global market for land) se focalise essentiellement sur la forte augmentation des dynamiques prédatrices d’acquisition de la terre observées depuis le milieu des années 2000 dans de nombreux pays d’Afrique, d’Amérique Latine, d’Asie et même d’Europe. Les bénéfices tirés par exemple de la culture des palmiers à huile pour la production alimentaire ou de celle des biocarburants constituent un des principaux moteurs de l’acquisition de ces terres par des firmes et des gouvernements étrangers toujours plus nombreux et variés. De tels processus de privatisation de masse ne sont en outre rendus possibles que parce que les pays « occupés » sont lourdement endettés et donc fragilisés structurellement, en particulier pour un certain nombre d’entre-eux par les programmes d’ajustement imposés par la Banque mondiale et le FMI dans les années 1980. L’hétéronomie faisant loi, les projets d’acquisition constituent, aux yeux des pouvoirs publics concernés, des opportunités notamment fiscales à ne pas manquer ; aux dépens des petits paysans violemment dépossédés et déplacés de leurs terres, de l’extrême pollution des sols et des eaux autour des champs de plantation ; et au risque de perdre un peu plus de leur souveraineté nationale. Dans le chapitre 3 (Finance and its capalities), Saskia Sassen revient sur la financiarisation de l’économie mondiale au profit des intérêts privés et sur la complexification croissante de ses instruments. Elle démontre alors avec précision, à travers l’exemple de la crise des subprimes aux Etats-Unis, comment l’habitat est devenu au cours des années 2000 un instrument financier global et redoutable d’une extrême opacité. La transformation progressive des crédits immobiliers classiques en formes d’investissements spéculatifs susceptibles d’être sécurisés, achetés ou vendus sur les marchés constitue un des éléments qui ont contribué à délier ces crédits de la situation réelle des ménages, et à les dériver, quand ils sont toxiques, en instruments de saisies et d’expulsions. Enfin, le chapitre 4 (Dead land, dead water) s’attache à décrire les multiples formes, souvent irrémédiables, de pollution et de destruction environnementales dont sont à l’origine d’autres secteurs économiques arrimés au monde de la finance. L’industrie, l’extraction minière, le nucléaire, l’exploitation des eaux terrestres sont quelques-uns de ces secteurs qui, toujours au nom de la recherche de profit, développent des procédés techniques, comme celui de la fracturation hydraulique, de plus en plus prédateurs pour les écosystèmes et les sociétés. Saskia Sassen illustre bien, une nouvelle fois, toute la tension qui existe entre la complexité des instruments financiers et technologiques mobilisés et la brutalité de leurs effets sociaux et écologiques.
Au total, avec cet ouvrage dont la lecture est facilitée par la précision des introductions de chapitres, par les nombreuses conclusions intermédiaires ou encore par la richesse de l’iconographie, Saskia Sassen défend une thèse séduisante qui s’appuie sur une démonstration charpentée. Cette dernière pourrait toutefois être encore plus convaincante si l’auteur réussissait vraiment, comme elle le répète pourtant tout du long, à rester proche du terrain (« on the ground ») et à nourrir sa réflexion de données empiriques plus fouillées. On passe ainsi très vite d’un cas à l’autre, comme dans le chapitre 4 où en quelques pages on aborde le désastre écologique dû aux extractions dans la mine d‘Ok Tedi en Papouasie Nouvelle Guinée, le rôle de l’entreprise Nestlé dans la pollution des eaux au Brésil, et la catastrophe nucléaire de Fukushima au Japon, laissant ainsi parfois une impression de survoler les enjeux. Si les analyses économiques proposées dans l’ouvrage apparaissent robustes, celles des situations sociales d’expulsion sont moins précises. Les « expulsés », quand il s’agit d’êtres humains, sont en effet trop peu présents. Les témoignages sur le vécu de l’expulsion, qu’elle renvoie au déplacement forcé, à un déménagement, une expropriation, au chômage, ou encore à une incarcération, manquent cruellement ; des éléments sur la diversité des situations entre les groupes sociaux ou les individus manquent tout autant. Le propos apparaît ainsi souvent trop surplombant et simplificateur, ce qui à notre sens, peut être un des biais d’un travail essentiellement fondé sur l’analyse secondaire de sources primaires. A l’exception de la rapide référence à quelques luttes sociales, les « expulsés » sont donc presque toujours dépeints comme des victimes sans pouvoir ni marge de manœuvre, des « dominés qui survivent désormais à distance de leurs oppresseurs à savoir des systèmes complexes et obscurs d’individus, de réseaux, de machines ; ou bien qui sont des éléments intégrés de l’infrastructure pour le pouvoir, comme dans les villes globales (p. 11) ». Expulsions est un ouvrage profondément -et à juste titre- sombre et pessimiste, et il faut atteindre la dernière phrase et l’injonction de Saskia Sassen à étudier les « espaces des exclus » (spaces of the expelled) pour entrevoir un peu de lumière : « Les espaces des exclus sont multiples, se développent et se diversifient (…) Ce sont sans doute dans ces espaces de demain que de nouvelles formes d’économie locale, de nouveaux récits, et des modes inédits d’appartenance collective vont être inventés » (p. 222).

