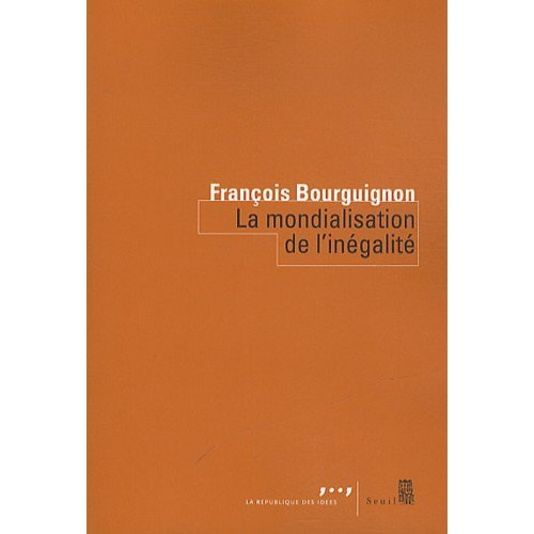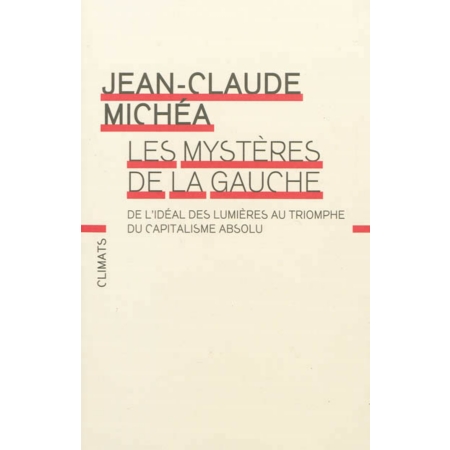Ce dixième ouvrage de Jean-Claude Michéa poursuit une réflexion entamée il y a maintenant plus de vingt ans sur le « logiciel libéral » et sur les forces sur lesquelles peut s’appuyer la résistance qui désirerait s’y opposer. Michéa s’adresse donc à « ceux qui croient encore à la possibilité d’une société libre, égalitaire et conviviale » (page 11).
Au vu des réactions récoltées, il y a de quoi être surpris. Remarqué par des polémistes de droite et d’extrême droite (Eric Zemmour, Alain Soral, Alain Finkielkraut, Alain de Benoist…), l’ouvrage a par contre reçu une volée de bois vert depuis la gauche, ou la gauche de la gauche (Philippe Corcuff dans Médiapart, Luc Boltanski dans Libération, Serge Halimi dans Le Monde diplomatique, Fréderic Lordon dans La Revue des livres). Certaines critiques ne sont pas sérieuses, notamment celle de Luc Boltanski qui relève de la simple malhonnêteté intellectuelle[1]. D’autres sont plus intéressantes, notamment quand elles proviennent des milieux anarchistes auxquels se réfère Michéa et dont se réclame aussi Philippe Corcuff [2]. Un double cordon sanitaire semble mis en place : d’un côté sauver la gauche des imprécations de Jean-Claude Michéa, c’est-à-dire continuer à faire fonctionner le couple gauche-droite structurant la vie électorale française, de l’autre, remonter encore d’un étage la barrière séparant diverses mouvances de l’extrême gauche qui seraient tentées par l’extrême droite… Michéa souligne lui-même : « J’ai décidément dû taper dans une sacrée fourmilière pour susciter ainsi une telle levée de boucliers ! On ne compte plus, en effet, les courageux croisés de la sociologie d’Etat qui ont jugé soudainement indispensable de mettre en garde le bon peuple – il est vrai déjà suffisamment échaudé par l’actuelle politique de la gauche – contre le caractère profondément hérétique et « réactionnaire » de mes analyses philosophiques » (« Réponse à Philippe Corcuff » , Médiapart, 2 août 2013.).
C’est que l’ouvrage s’inscrit dans un contexte particulier. L’année 2013 a été marquée par la démission du ministre du budget soupçonné de fraude fiscale (alors qu’il animait une politique d’austérité drastique), par le supposé « ras le bol fiscal » des Français, par le passage de la loi sur le « Mariage pour tous » et, en fin d’année (postérieurement à la polémique autour de Michéa), par la révolte des bonnets rouges. Tout ceci avec un gouvernement socialiste au pouvoir. Soit, globalement, un passage « à droite » de la contestation, y compris dans la rue, y compris violente. Dans la même période, un certain nombre d’intellectuels de gauche dont Emmanuel Todd, et, cas particulièrement intéressant ici, Frédéric Lordon, sont effectivement devenus contre leur gré des références assumées de l’extrême droite, notamment au Front National de Marine Le Pen. Cette proximité s’inscrit dans le virage étatiste et protectionniste du programme du Front National. Les analystes proches du Front de gauche comme Lordon, ou de ce qui reste de l’aile gauche du PS comme Todd sont alors aisément mobilisables sur le plan de la politique économique frontiste.
Tout semble alors pousser un certain nombre de personnages mécontents de cet embarquement forcé à réaffirmer leur opposition à tout le reste du programme des nationalistes. Notamment sur les sujets dits « sociétaux », « sociaux » ou « culturels ». Or, c’est à cet endroit précis que Jean-Claude Michéa, lui aussi embarqué à son corps défendant dans cette galère, fait très mal, puisqu’il travaille depuis des années à relier le libéralisme culturel de la gauche au libéralisme économique de la droite pour en montrer l’indispensable unité logique. Aux yeux de certains, Jean Claude Michéa travaillerait donc sournoisement à scier le garde-fou permettant de conserver des repères clairs ; une gauche culturellement libérale, une droite économiquement libérale. Lutter contre le « Jeanclaudemichéisme » et les « Jeanclaudemichéastes », ce serait donc se prémunir contre l’alliance des extrêmes, et donc contre le retour de la bête immonde dont le ventre est toujours fécond.
L’ouvrage a donc un double intérêt pour nous :
– Il s’inscrit dans le cadre des échanges politiques contemporains particulièrement vifs sur la question de la communauté à l’échelle de laquelle se pense et se pratique la justice sociale ou (pour ce qui nous intéresse) spatiale.
– Il nous permet de repenser, avec ou contre Orwell et Marcel Mauss (les deux principales références de Michéa), la place de la triple obligation du don (donner, accepter, rendre) et de son expression politique (la common decency) dans nos analyses de la justice. En d’autres termes, peut-il exister des formes indécentes de justice sociale ou spatiale, peut-il exister des formes décentes d’injustice?
Comme à l’accoutumé chez Michéa, l’ouvrage se compose d’un texte principal relativement court (58 pages) et de multiples « scolies » plus conséquentes. Le texte principal est une réponse demandée par Paul Ariès, animateur du site « Les Zindignés » à la lettre d’un professeur de philosophie de Besançon, Florian Gulli, sympathisant du PCF et du Front de Gauche, à propos du rejet par Michéa du terme de « gauche ».
Michéa pose cette question de terminologie comme essentielle. Soit le « signifiant maître » est sauvable, au prix d’un examen critique de la contamination de la gauche par trente ans de néolibéralisme. Soit il ne l’est pas et doit être abandonné car il appartient tout entier au « logiciel » du libéralisme. Michéa bâtit ensuite toute sa réflexion en faveur de la seconde hypothèse en se référant explicitement à Cornelius Castoriadis : « seul le langage commun permettra de résoudre dialectiquement-à la différence d’une alliance purement électorale- les différentes contradictions au sein du peuple ». Car Michéa croit au peuple – pétri de contradictions- mais porteur de valeurs propres, c’est-à-dire communes, au double sens du terme anglais (commons) c’est-à-dire collectives et ordinaires.
Ce peuple-là, porteur des valeurs de la décence ordinaire (common decency), provient de vingt ans de travail sur l’œuvre de George Orwell. Héritage qu’il partage avec Jaime Semprun et les éditions de L’Encyclopédie des nuisances qui ont contribué à republier et à commenter les écrits politiques du militant socialiste, un peu oublié au profit du romancier. La common decency, pour aller vite (et c’est volontaire chez Michéa), c’est « le sentiment, largement partagé dans les classes populaires, de savoir ce qui se fait et ce qui ne se fait pas ». Michéa assoit ensuite cette figure politique (disons, d’une morale aux aspects politiques directs) sur un substrat anthropologique : la common decency dériverait de la triple obligation de donner, accepter et rendre, une notion définie par Marcel Mauss et reprise ensuite par Karl Polanyi comme par le groupe M.A.U.S.S. (Mouvement anti utilitariste en sciences sociales).
Proche dans ses références du mouvement situationniste (nombreuses citations de La société du spectacle de Guy Debord), Michea s’inscrit enfin dans la veine d’un marxisme débarrassé de ses aspects déterministes, d’où par exemple ses multiples références au vieux Marx, entretenant une correspondance iconoclaste avec les populistes russes Nikolaï Mikhaïlovski et Vera Zassoulitch. Marx s’y accordait avec les populistes pour penser la possibilité d’atteindre le socialisme sans passer par le stade capitaliste, notamment en s’appuyant sur la communauté paysanne russe, le mir.
Sur le fond, la démonstration philosophique s’appuie sur deux moments fondateurs. Le premier part des guerres de religions qui ravagèrent l’Europe au XVI° siècle. Ces guerres engendrèrent un mouvement philosophique particulièrement pessimiste puisqu’il s’agit d’inventer des lois garantissant la paix sans avoir à reposer sur la vertu des sujets. C’est ce que Michéa avait déjà longuement développé dans L’Empire du moindre mal (Climat, 2007) : « Kant note dans son projet de paix perpétuelle (…) que dans l’hypothèse d’un travail législatif parfait, la seule mécanique du droit suffirait à assurer la coexistence pacifique même d’un peuple de démons » (L’Empire du moindre mal, p. 37). Le libéralisme nait alors de cette revendication, et il constitue dans sa première mouture, celle de David Hume ou d’Adam Smith, une totalité politique et économique. Dans cette perspective, le droit se doit d’être neutre, et de ne pas porter de valeurs morales puisque toutes ces valeurs morales sont contestables et potentiellement dangereuses : « Les formules de Benjamin Constant sont d’une limpidité exemplaires : ‘Prions l’autorité – écrit-il ainsi- de rester dans ses limites : quelle se borne à être juste, nous nous chargerons d’être heureux » (L’Empire du moindre mal p. 35). C’est la primauté du juste sur le bien. Et le deus ex machina capable d’orchestrer un tel ballet n’est autre que la main invisible d’Adam Smith qui transmute les vices privés en vertus publiques : « Il s’agissait donc d’entendre par là que c’est la libération intégrale des échanges économiques (…) qui en plaçant la société juste sous la protection tutélaire des lois de l’offre et de la demande va se charger d’elle-même, par un processus purement mécanique, d’engendrer cette communauté à la fois pacifique et solidaire ».
Invité à France Inter en 2012, Michéa avait eu une image saisissante : Si on avait mis une guitare entre les mains de David Hume, on aurait obtenu un George Brassens, c’est-à-dire quelqu’un qui ne demandait rien à personne pour suivre son chemin de petit bonhomme, si possible à l’abri des braves gens qui n’aiment pas que l’on suive une autre route qu’eux.
Mais il poursuivait en disant que Hume serait sidéré de voir à quoi ont abouti ses idées, au moins autant qu’un Marx visitant l’Union Soviétique. Ceci parce que cette conception libérale naissante du laisser-faire privé s’appuyait en fait sur une société où des millions de choses, des petits détails de la vie quotidienne, y étaient régulées par la règle du don maussien et non pas par l’échange marchand. Domaines que ni Smith ni Hume ne comptaient remettre en cause, mais qui ont depuis été balayés par l’extension du domaine de l’économie (Ce que Karl Polanyi appelait de son côté le « désencastrement » de l’économie vis-à-vis de la société).
Cette extension du domaine de la marchandise, heurte, à chaque époque et en chaque lieu la common decency des populations qui la subissent. Car, même non verbalisée, il y a toujours la conscience que certaines choses ne se font pas. Or, la dynamique logique libérale, le « logiciel libéral » comme l’écrit Michéa, a toujours fait reculer les limites de ce qui peut se faire, notamment à partir du moment où des pans entiers de l’économie du don ont été pénétrés par l’échange marchand. Pour filer la métaphore, Michéa évoque alors un Brassens, porteur lui aussi d’une common decency, qui n’apprécierait pas que le petit bonhomme suive son chemin en pillant, violant et tuant et en réclamant en plus le silence des braves gens. Michéa est un moraliste.
Un moraliste socialiste. Et c’est bien là que le divorce avec la gauche s’explique. Dans Les mystères de la gauche, il revient longuement sur la naissance historique de la gauche, au lendemain de la Révolution française, et qui figure alors un ensemble entièrement libéral, opposé aux conservateurs, aux réactionnaires (notamment aux partisans de l’Ancien Régime) qui constituent la droite. Il rappelle que le mouvement ouvrier, le mouvement socialiste, nait alors d’une opposition à cette gauche libérale qui porte les valeurs d’une industrialisation destructrice des communautés de base de la vie. Il rappelle l’opposition de TOUTE la gauche à la Commune de Paris de 1871, le soutien sans faille de Ferry, de Zola et de Hugo à Adolf Thiers. Ce n’est selon lui que l’affaire Dreyfus qui a permis, dans une alliance des socialistes et de la gauche, d’unir les forces contre des menaces réactionnaires bien réelles. Mais cette alliance a eu un prix. La gauche du XX°siècle est alors le parti du mouvement, l’incarnation du libéralisme dans sa face culturelle, alliée à un socialisme qui a accepté le legs marxiste des « stades nécessaires du développement des forces productives », et qui impose les changements sociétaux rendus nécessaires par l’expansion sans fin du domaine de la marchandise. Ceci au nom de la lutte contre les conservatismes : « l’opérateur philosophique majeur (…) n’est autre que cette métaphysique du progrès et du ‘sens de l’histoire’ qui définissait depuis le 18° siècle le noyau dur de toute les conceptions bourgeoises du monde. Métaphysique qui constitue donc le véritable ‘code source’ de la gauche originelle (…) qui allait contaminer des pans entiers du mouvement socialiste » (Les mystères de la gauche, p. 23).
Depuis 1945 (avec la chute de ce qu’il considère comme la dernière menace réellement réactionnaire), portée par les héritiers du compromis lié à l’affaire Dreyfus, Michéa voit donc surtout une gigantesque entreprise de désocialisation partagée entre la gauche et la droite.
– Une gauche qui prétend (de moins en moins !) s’opposer aux dogmes de l’économie libérale mais qui mène un mouvement volontariste de rattrapage sur le plan législatif, au nom du ‘progrès’, des conséquences logiques de l’ouverture des marchés économiques. La gauche validerait ainsi des états de faits et préparerait les futures avancées du marché.
– Une droite qui prétend défendre les valeurs ‘traditionnelles’ qu’elle détruit elle-même par son libéralisme économique.
Selon Michéa, jamais un gouvernement de droite ne peut endosser le volet culturel de l’affaire libérale (défaite de Valérie Giscard d’Estaing en 1981, notamment après le vote de la loi Veil sur l’avortement), ni la gauche endosser son volet économique (les perspectives électorales actuelles du parti socialiste). Michéa note aussi que dans ce jeu étrange, un gouvernement de gauche ne remet que rarement en cause les décisions économiques des précédents gouvernements de droite, et qu’inversement, un gouvernement de droite ne remet pas souvent en cause les décisions sociales et culturelles des gouvernements de gauche (abolition de la peine de mort, PACS…).
La dynamique générale de ce système libéral est présentée comme sinistrogyre (déviée vers la gauche). Michéa s’appuie ici, c’est assez rare pour être signalé, sur un géographe (le Tableau des partis en France d’André Siegfried, 1913) pour affirmer que dès le début du 20° siècle, les commentateurs politiques remarquaient que la « droite » était une ancienne « gauche », qui suivait avec un temps de retard, les évolutions promues par les brefs passages de la gauche aux affaires (voir par exemple le destin du parti radical de George Clemenceau).
En renvoyant au conservatisme de droite une grande partie des réactions de ceux qui souffrent de la destruction de la sphère non marchande réglée par le don, la gauche s’interdirait ainsi de penser le contenu positif et politique de la common decency. Le peuple n’est plus alors composé que de beaufs, de ploucs… C’est une masse.
Michéa pose alors directement la question du « petit peuple de droite » : employés, commerçants, agriculteurs… Il s’agit de «l’aider ainsi à tourner sa colère et son exaspération grandissante contre ce qui constitue en dernière instance, la cause première de ses malheurs et de ses souffrances, à savoir ce système libéral qui ne peut croitre et prospérer qu’en détruisant progressivement les valeurs morales auxquelles ce petit peuple de droite est encore profondément – et légitimement- attaché ». Et, symétriquement, la question de l’élite de gauche : « De fait, l’existence par exemple d’un « réseau éducation sans frontières » (ou de toute autre association caritative essentiellement animée par des fonctionnaires) n’a, par elle-même, rien de très surprenant. Ses membres n’ont presque jamais à assumer personnellement le prix réel de leur bonne volonté humanitaire. On imagine assez mal en revanche, les travailleurs du bâtiment – surtout ceux qui sont en CDD- mettre d’eux-mêmes en place un réseau ‘Bâtiment sans frontières’ destiné à faire venir en France des travailleurs des pays de l’est ou du ‘tiers monde’ qui accepteraient d’être encore plus mal traités et payés qu’eux » (page 114).
Avec les évolutions actuelles du programme du Front national, et avec surtout les succès électoraux qu’on lui connait… On comprend maintenant pourquoi Jean Claude Michéa est le diable… On lui a reproché d’être un nationaliste et un raciste caché et d’entretenir un grand flou intellectuel (notamment par son usage central de la common decency et son refus de lui donner un contenu positif). Il a répondu à ces critiques, point par point, et avec un certain humour dans sa « Réponse à Philippe Corcuff » déjà mentionnée (Médiapart 2 août 2013).
Pour ce qui nous concerne plus précisément, je retiens que les ouvrages de Michéa posent de manière implicite une question qui me semble fondamentale : une société obnubilée par la question de la justice sociale ne peut –elle pas être dans le même temps totalement indécente, en termes orwelliens ? C’est une question que j’avais ouverte dans l’ouvrage édité suite au colloque fondateur de notre revue, à Nanterre en 2008[3], et qui demeure pour moi, toujours aussi importante.
[1] « Le philosophe Jean-Claude Michéa est typique de ce courant de pensée, comme le sont souvent les invités de Répliques, l’émission d’Alain Finkielkraut. Ces discours stigmatisent, en général, deux types d’ennemis. A l’extérieur, les pays émergents, qui ont déjà ruiné nos ouvriers et qui veulent maintenant ruiner ce qui nous reste de paysans. A l’intérieur, les Arabes, qui menacent nos valeurs ancestrales. A chaque fois, il s’agit de véritables discours de guerre. Ce qui est fâcheux, c’est que ces discours typiquement de droite ou d’extrême droite trouvent désormais des modalités d’expression à gauche ou à l’extrême gauche, notamment autour du thème de la laïcité et en se réclamant du républicanisme. ». Libération, 13 septembre 2013. On ne trouvera nulle trace dans les écrits de Jean Claude Michéa de tels appels à la haine, et bien des développements parfaitement contraires.
[2]Frédéric Lordon : « Impasse Michéa » (La revue des livres. Juillet – aout 2013). Serge Halimi : « Le laissez-faire est-il libertaire ? » (Le Monde diplomatique juin 2013). Philippe Corcuff : « Intellectuels critiques et éthique de responsabilité en période trouble : Michéa, Durand, Keucheyan, Kouvelakis… » (Médiapart, 25 juillet 2013). Sur les sites «communistes- libertaires », on pourra consulter Vosstanie : « Encore ? De l’ontologie de Jean-Claude Michéa (National-nostalgique ?) » ; ou encore Mondialisme.org : « A propos du réac Jean-Claude Michéa (alias Nietzschéa), des Editions l’Echappée et de leur « vigilance »… en carton-pâte ».
[3]Gardin J. Justice ou décence environnementale ? in Blanchon D. Gardin J. Moreau S. (dir.) 2012. Justice et Injustices environnementales. Presses Universitaires de Paris Ouest.
More