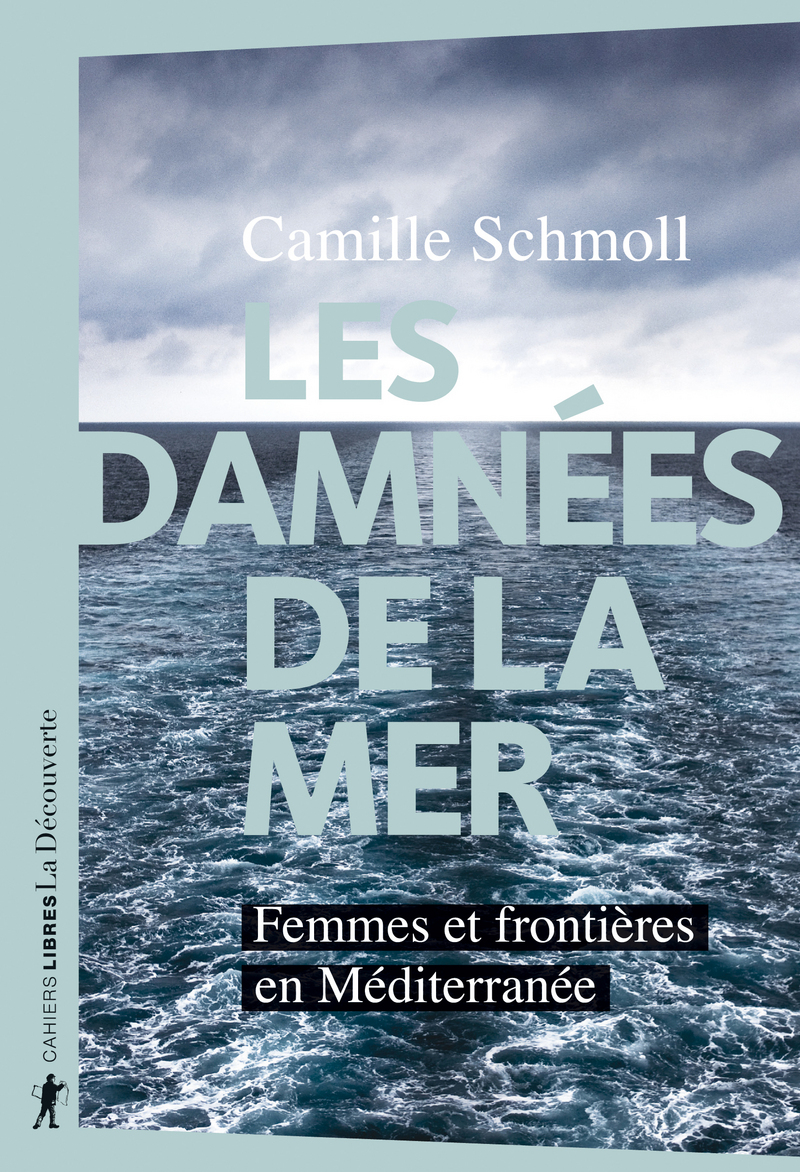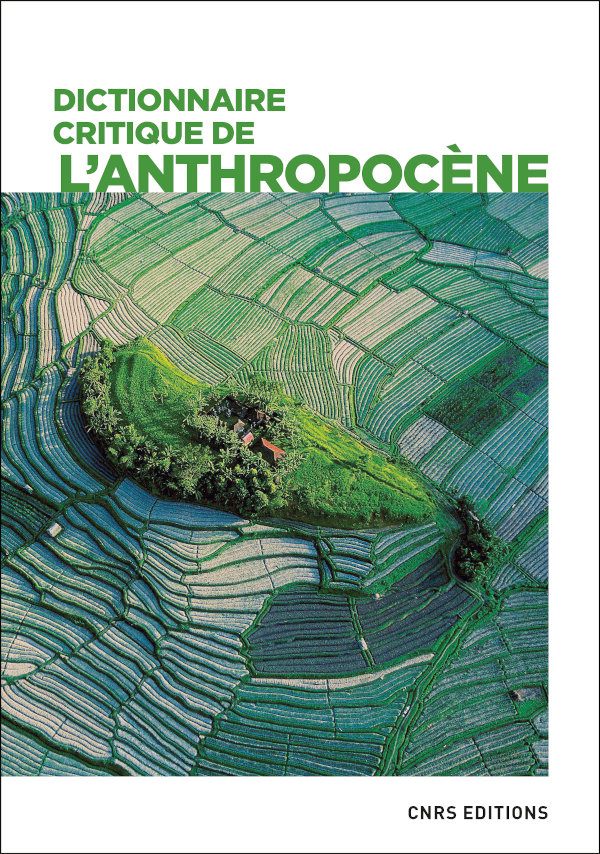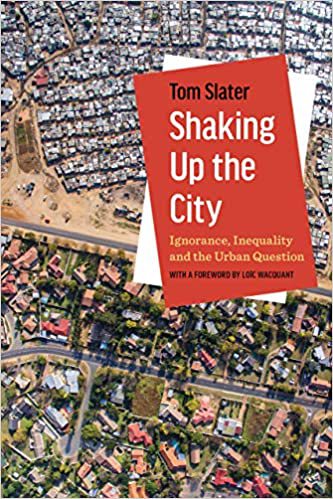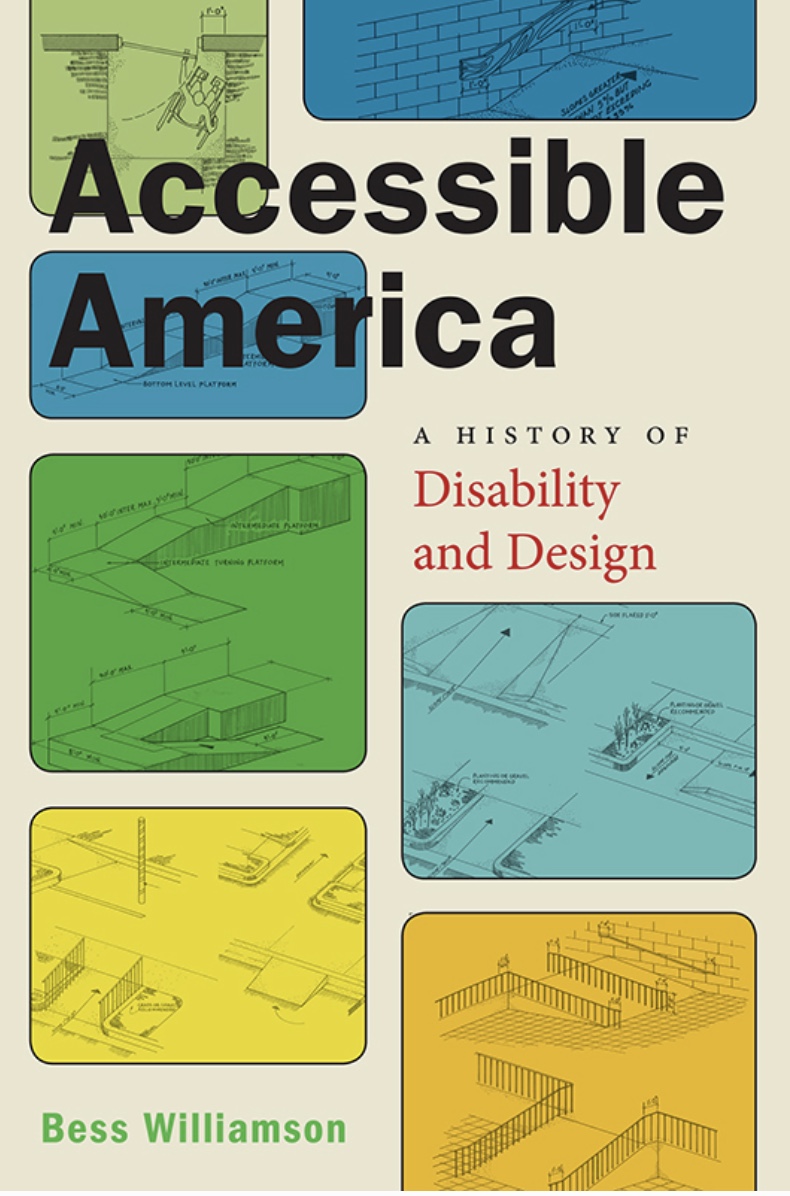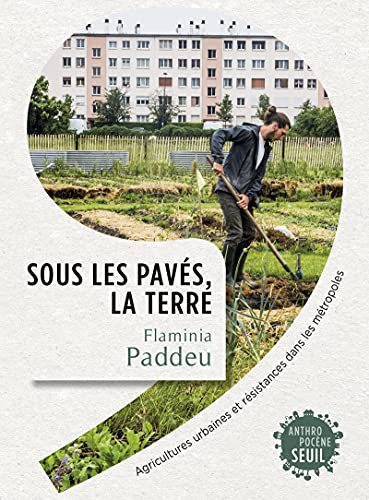Géographies féministes en pratique
Journée du 12 mars 2021 | commenté par : Judicaëlle Dietrich et Marion Tillous
Le 12 mars 2021 a eu lieu à Lyon et dans différentes villes de France une journée d’étude consacrée aux Géographies féministes en pratique organisée par la commission de Géographie féministe du Comité national français de géographie (CNFG)[1] avec le soutien de la commission de Géographie critique. Cette journée est la première de rencontres annuelles dont l’objectif est d’ouvrir un espace d’échange et de partage facilitant le développement d’outils communs et la consolidation d’un collectif de géographes féministes en France.
Grâce à un format hybride, elle a permis la tenue de plénières, d’ateliers et d’une assemblée générale. Et le présent compte-rendu en est l’un des modes de restitution. En effet, si nous étions d’accord au départ avec l’idée qu’une performance qui laisse des traces est une mauvaise performance, comme le formule Esther Ferrer[2], la mise à distance de nos rapports sociaux et les contraintes sanitaires ont nécessité de trouver des stratégies de diffusion et d’archivage des discussions sur lesquelles nous reviendrons.
En parallèle de ce compte-rendu ; un podcast a ainsi été enregistré et sera accessible sur la plateforme SPECTRE ; un fanzine[3] permet de retrouver les questionnements, émotions et points d’attention des participant·e·s et un article sur les pédagogies féministes écrit par Maria Kherbouche, étudiante de master et donc depuis ce point de vue situé, va être publié dans les Carnets d’enseignement de la revue Carnets de géographes. Enfin, ce texte paru dans JSSJ a v·lu vise à retranscrire, en guise de point d’étape, le déroulement de cet événement scientifique et humain.
Après la présentation des raisons qui nous ont amenées à préparer cette journée d’étude, nous reviendrons sur sa tenue et son organisation concrète. Ensuite, nous tenterons de montrer quels sont les principaux apports théoriques et pratiques des différentes sessions pour finir sur quelques points d’attention qu’il nous semble important de relever pour la mise en place de futures rencontres.
Pourquoi organiser une journée de la commission de Géographie féministe ?
Lorsque nous avons été nommées coresponsables de la commission de Géographie féministe, sur proposition de ses fondatrices, les activités de cette dernière étaient en dormance. Non pas parce que la commission aurait manqué d’intérêt ou de légitimité, mais parce que l’une de ses fondatrices, Rachele Borghi, a subi les attaques de l’extrême droite en tant qu’intellectuelle queer/féministe. Et qu’elle n’a reçu aucun soutien de son institution[4], ce qui a eu des impacts forts sur sa santé et son travail. Nous avons donc souhaité réactiver cette commission pour créer un espace dans lequel les géographes féministes et antiracistes pourraient trouver du soutien et de la bienveillance dans un cadre d’échanges sécurisant.
Pourquoi le faire sous l’égide du CNFG ? Dans un contexte d’attaques en règle des savoirs critiques, qui avait déjà commencé à se faire entendre à travers des voix officielles[5], au moment où nous avons pris la décision d’organiser cette journée, à l’été 2020, il nous a paru utile de donner un cadre institutionnel à ce moment d’échanges. Il s’agissait notamment d’agir pour que les jeunes chercheur·se·s, qui ont témoigné d’un certain désarroi en constatant que leur inscription dans des approches critiques pouvait leur porter préjudice dans leur carrière, puissent se rassurer sur la légitimité de leurs travaux. C’est également la raison pour laquelle il a semblé essentiel et presque évident de mettre en place cette journée en collaboration avec la commission de Géographie critique du CNFG.
Nous avons donc imaginé cette journée comme une manière d’ouvrir une porte vers un espace de parole et d’échange. Les militantes et chercheuses féministes ont montré l’importance de créer des espaces de partage d’expériences non seulement afin que des outils d’autodéfense face aux discriminations et aux violences puissent être partagés, mais aussi pour qu’il puisse y avoir reconnaissance du préjudice, de l’injustice, voire du traumatisme subis. Lorsque nous avons pris la décision d’organiser cette journée, la commission ne comprenait que 11 membres. Finalement, plus de 90 personnes se sont inscrites à cette journée, sans compter celles qui ont coordonné les ateliers. Les temps de parole ont donc été beaucoup plus restreints que prévu, malgré notre intention première. Néanmoins, les ateliers les plus orientés vers les échanges d’expérience, c’est-à-dire ceux portant sur les pédagogies féministes et sur les conditions de travail, ont été réalisés en petit comité (15 participant·e·s maximum), tandis que les ateliers destinés à échanger sur les objets de la géographie du genre et les épistémologies féministes en géographie ont permis de réunir un plus grand nombre de personnes.
Notre seconde intention était de tenter d’aller au-delà de l’éclatement des géographies féministes françaises et francophones. Nous n’avons surtout pas voulu créer une géographie féministe unitaire, mais commencer à créer un mouvement œuvrant au dépassement de clivages qui nous affaiblissent face à une opposition réactionnaire de plus en plus vivace. Dans cette perspective, la dimension matérielle de l’organisation de la journée a été décisive.
Modalités de l’organisation
La journée du 12 mars s’est inscrite dans le contexte sanitaire de la COVID-19, contexte difficile que nous connaissons depuis le début de l’année 2020. Au moment où nous l’avions programmée, nous espérions encore une rencontre « en présentiel » comme on le dit désormais. Rapidement, et pour permettre également à des personnes fragiles, ou vivant dans des pays limitrophes, voire en mission sur le terrain de participer à la journée, le mode hybride s’est imposé. L’important nombre d’inscrit·e·s a également joué en faveur de cette modalité. À cette période, la jauge autorisée pour une pièce était limitée à six personnes. À Lyon, une partie des responsables des ateliers et des communicant·e·s ainsi que quelques participant·e·s ont pu se rassembler, avec les organisatrices, dans deux salles voisines et connectées. Des pôles locaux rassemblant cinq à six personnes se sont aussi organisés à Grenoble et à Aubervilliers.
L’accessibilité des ateliers et des plénières en visioconférence a sans aucun doute permis de diffuser bien plus largement nos échanges et de rassembler un plus grand nombre de participant·e·s, et donc de statuts et de trajectoires qui témoignent de la nécessité de rendre ces moments possibles. Comme seule précaution, étant donné la sensibilité de certains sujets et l’exposition à diverses formes de violence pour plusieurs collègues, nous avons choisi d’imposer une inscription préalable, gratuite, pour ne transmettre les liens de connexion qu’aux seules personnes concernées et non pas sur les réseaux sociaux et des listes de diffusion. Cela a également impliqué une vigilance collective constante pour garantir les temps et tours de parole au sein des ateliers, gérer les moments de travail en sous-groupes, s’assurer que tous·te·s soient entendu·e·s malgré le grand nombre de participant·e·s et des statuts ou des habitudes de parole en public très différents.
En revanche, le passage de la journée en distanciel n’a pas eu que des avantages : (dé)connexions en cours de session, fatigue de passer une journée seul·e devant un écran, difficultés à saisir le langage corporel pouvant témoigner d’inconfort ou de désaccord. Nous avons également cédé à la facilité d’enregistrer les échanges, ce qui est très utile pour l’écriture du présent compte-rendu par exemple, mais a aussi pu mettre mal à l’aise certain·e·s participant·e·s, à qui nous n’avions pas demandé leur autorisation.
Par conséquent, nous souhaitons garder en tête, pour de futures éditions, l’importance de réaliser ces ateliers en les rendant uniquement, ou au maximum, accessibles en présentiel, ce qui permettra de créer des espaces plus restreints et plus safe, et en organisant y compris des espaces en non-mixité. Nous ne pouvons que sortir plus convaincu·e·s de la valeur de la rencontre et des discussions informelles et, puisque les échanges dans les pôles locaux ont permis de désamorcer certaines barrières liées aux positions institutionnelles, c’est vers ces possibilités et ces changements dans les rapports de domination que nous avons envie d’aller ensuite, dans nos pratiques professionnelles et d’enseignement, ainsi que lors de nos prochaines rencontres.
Déroulement de la journée
Après l’introduction de rigueur, une intervention de Marianne Blidon (université Paris 1 Panthéon Sorbonne) a marqué le début de la journée d’étude. Intitulée « De quoi la géographie féministe est-elle le nom ? », cette riche présentation a permis de revenir sur la place des géographies féministes à travers le monde. Dans un contexte de mobilisations générales autour du féminisme et d’instrumentalisations diverses, un agenda politique, qui conduit aussi à une connexion croissante entre le travail universitaire et l’actualité, s’est constitué. L’institutionnalisation des géographies féministes s’appuie sur des associations professionnelles, des colloques et manifestations scientifiques qui témoignent d’une place de moins en moins marginale de ce champ disciplinaire. Marianne Blidon a ainsi pu mettre en évidence les inégalités de répartition géographique des universitaires qui se disent (et peuvent se dire) féministes, entre autres du fait de formes d’autocensure (par manque de légitimité, réel et/ou ressenti) ou du fait des contraintes sur les carrières que constitue le fait de se positionner en tant que féministe. De plus, si la présence de géographies féministes se constate dans de nombreuses régions du monde, on ne peut que remarquer des circulations inégales, notamment pour des raisons linguistiques, expliquant là encore une situation hégémonique anglophone.
L’atelier sur les épistémologies féministes animé par Karine Duplan (université de Genève) et Claire Hancock (université Paris Est Créteil) a été l’occasion d’acter que la géographie du genre est une partie, mais pas la seule, des géographies féministes, et que celles-ci ne doivent pas être réduites à une géographie des femmes par les femmes. C’est un champ marqué par des énoncés descriptifs, pour rendre compte des inégalités (de genre souvent), ainsi que par la production d’énoncés normatifs, permettant d’identifier ce qui relève d’une oppression et de dire ce qui devrait être mis en place pour y mettre fin. Il s’agit donc d’un corpus de théorie, d’une praxis qui s’adosse à une éthique, d’une géographie qui se travaille, sans être une donnée a priori. Dans l’ensemble, les géographies féministes contribuent à définir et à démontrer les rapports de domination de genre et de sexualités en mettant en évidence leurs résonances, leurs intersections voire leurs consubstantialités avec d’autres rapports de domination, notamment racistes. Le positionnement défendu vise une (re)mise en question critique de la naturalisation des faits sociaux, avec une constante attention sur l’application de ces rapports de domination par la violence. Ainsi, ces deux communicantes ont rappelé que l’un des apports fondamentaux de la géographie féministe est avant tout le refus de l’idée qu’une production scientifique pourrait s’affirmer comme neutre et objective, pour montrer que la « positionnalité » du ou de la chercheur·se – c’est-à-dire le fait de rendre compte à la fois de sa position dans les rapports sociaux qui font sens au regard de sa recherche (sexe, classe, race, âge, orientation sexuelle, handicap, etc.) et de son positionnement dans le champ politique – est une condition de la production de la recherche et de sa scientificité. Pour résumer, l’épistémologie des géographies féministes permet d’identifier des thématiques, des objets, des méthodes… qui apparaissent de moins en moins spécifiques, mais que la géographie féministe contribue à renouveler, dans les manières de faire, de penser, voire d’écrire.
L’atelier Géographies féministes en temps de crise visait initialement à faire le point sur l’actualité des objets relevant de la géographie du genre. Ses animatrices, Sophie Blanchard et Amandine Chapuis ont recensé les derniers articles parus en géographies francophone et anglophone pour les comparer. Elles ont montré que si, dans le monde francophone, les recherches sur des objets féministes et intersectionnels se multiplient dans le sillage des mouvements #MeToo et Black Lives Matter, les recherches qui portent sur d’autres objets géographiques restent aveugles au genre et à la race. Dans le domaine anglophone au contraire, les études de genre et intersectionnelles sont très répandues, y compris dans des revues qui n’affichent pas de positionnement critique. Les recherches francophones sur ces sujets se fondent presque exclusivement sur des méthodes qualitatives : récits de vie, entretiens, observation participante, etc. En plus d’une ouverture nécessaire vers des approches quantitatives ou des méthodes mixtes qui reste à créer en géographie, l’atelier a également rappelé l’enjeu féministe qu’il y a à reconnaître la valeur heuristique des méthodes qualitatives et à inventer des formes de diffusion des connaissances produites autres que les publications (et en plus d’elles), formes qui seraient plus accessibles et plus joyeuses.
Pour l’atelier portant sur les conditions de travail, nous n’avons, volontairement, pas produit de synthèse, considérant que les échanges y ayant lieu seraient plus utiles que des informations diffusées en tant que telles, et qu’ils seraient plus nourris s’ils se savaient effectués dans un cadre confidentiel. Malgré cela, il nous semble qu’une des interactions advenues pendant l’atelier est importante à rapporter. Celle-ci a été introduite par une participante qui a fait le récit du racisme qu’elle a subi dans l’enseignement supérieur et la recherche – récit qui, nous l’espérons, pourra être publié. Lorsqu’elle a terminé son intervention, une enseignante-chercheuse blanche titulaire a pris la parole pour faire le récit de discriminations qu’elle a elle-même subies, dans lesquelles elle se trouvait en position dominée quant à des rapports de classes, et au cours desquelles ses privilèges de blanche ont été utilisés contre elle. Bien que relevant aussi du récit d’une expérience de domination, cette seconde intervention est apparue comme une négation du récit précédent, une manière de ne pas reconnaître le préjudice vécu, et ce, d’autant plus que l’échange ne s’est pas fait entre des personnes au statut comparable et ni ayant une maîtrise égale des codes sociaux liés à l’atelier. Cette situation a montré les limites de cette première journée : créer des espaces de parole n’est pas suffisant, il nous faut créer des espaces d’écoute. Ce à quoi nous allons nous atteler pour la suite.
Remerciements
L’organisation de la journée d’étude a bénéficié du soutien financier du CNFG et de l’appui matériel technique et technologique du laboratoire Environnement ville société – UMR 5600. Nous les en remercions sincèrement.
Merci à tous·te·s les participant·e·s pour leur présence, leur enthousiasme et la qualité des échanges. Nous remercions particulièrement Maria Kherbouche, Mari Oiry-Varacca ainsi que toute l’équipe de SPECTRE.
[1] La commission de Géographie féministe du CNFG a été créée en 2017 par Rachele Borghi et Émilie Viney. Elle vise non seulement à favoriser le développement d’objets de recherche propres à la géographie du genre, mais également à encourager les pratiques féministes dans l’enseignement, la recherche et la vie professionnelle de la géographie française.
[2] Barbut Clélia, Raconter la performance : l’entretien comme cadre pour la reprise et la transmission des performances. Entretiens avec Esther Ferrer et Nil Yalter, 2017 (https://doi.org/10.7202/1041081ar).
Ferrer Esther, « La performance : institutionnalisation, théâtralisation, dangers de l’événementiel », Inferno, 24 avril 2014 (https://inferno-magazine.com/2014/04/24/entretien-avec-esther-ferrer/, consulté le 26 novembre 2021).
[3] Disponible sur demande en écrivant à l’adresse : geofeministe@cnfg.fr.
[4] Borghi Rachele, Décolonialité & Privilège. Devenir complice, Villejuif, Éditions Daronnes, 2020.
[5] En l’occurrence celle du président Macron, qui a déclaré dans le journal Le Monde du 10 juin 2020 : « Le monde universitaire a été coupable [parce qu’]il a encouragé l’ethnicisation de la question sociale en pensant que c’était un bon filon. ». Les attaques « officielles » se sont multipliées au cours de l’année 2020-2021 à la suite de l’assassinat de Samuel Paty, mais elles ont des racines plus anciennes. Voir le colloque La savante et le politique, 7-10 juin 2021.
More