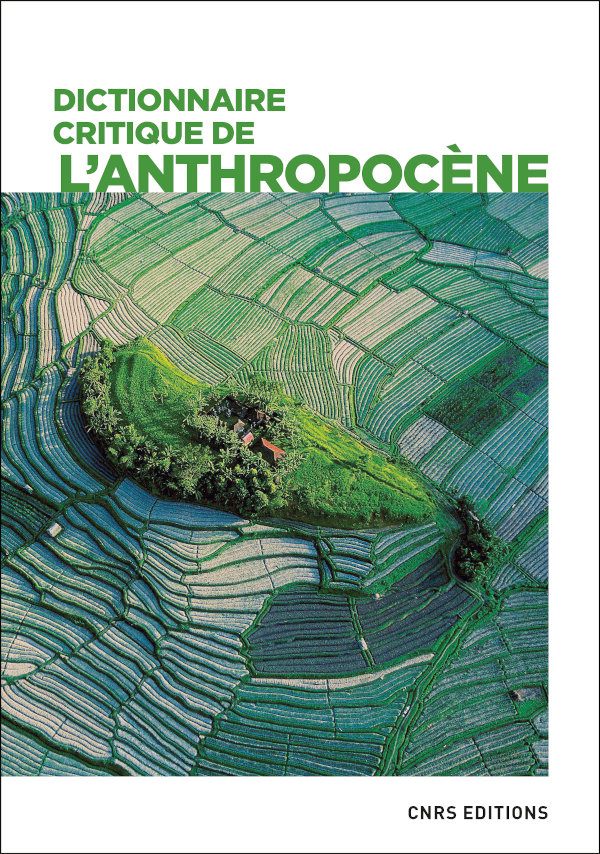
Groupe Cynorhodon
Dictionnaire critique de l’anthropocène
CNRS Éditions, 2020, 944 p. | commenté par : Annaig Oiry
La parution du Dictionnaire critique de l’anthropocène est à replacer dans un contexte plus général de repolitisation des questions environnementales en géographie et de remise en question des choix politiques qui ont mené à la transformation des écosystèmes. En cela, l’ouvrage s’inscrit dans la lignée des réflexions initiées par Denis Chartier et Estienne Rodary dans leur Manifeste pour une géographie environnementale (2016). Le groupe Cynorhodon – du nom du fruit de l’églantier, connu pour fournir le « poil à gratter » – signe ce dictionnaire. Ce collectif est composé de seize géographes (Frédéric Alexandre, Fabrice Argounès, Rémi Benos, David Blanchon, Frédérique Blot, Laine Chanteloup, Émilie Chevalier, Sylvain Guyot, Francis Huguet, Boris Lebeau, Géraud Magrin, Philippe Pelletier, Marie Redon, Fabien Roussel, Alexis Sierra, Didier Soro) et s’engage dans une entreprise de « remise à l’heure » de la géographie sur le concept d’anthropocène. En effet, les écrits et manifestations scientifiques portant sur l’anthropocène en sciences sociales sont majoritairement à l’initiative de non-géographes : en témoigne le colloque Comment penser l’anthropocène ? Anthropologues, philosophes et sociologues face au changement climatique, organisé, en 2015, au Collège de France à Paris.
Dès l’introduction, le collectif Cynorhodon montre comment, par la notion d’anthropocène, s’ouvre une nouvelle voie pour la géographie, longtemps suiviste des injonctions au « développement » puis au « développement durable ». En réinvestissant le champ de l’interface entre la nature et les sociétés, les auteurs du dictionnaire se donnent pour objectif d’analyser avec un œil critique le récit anthropocénique selon lequel l’espèce humaine est devenue un agent géologique majeur, notamment du fait de la « modernité industrielle ». Le dictionnaire réussit le pari d’examiner les ambiguïtés de ce récit, en montrant à la fois que ce dernier permet de mettre en lumière les dégradations environnementales perpétrées par les sociétés, mais qu’il peut également être instrumentalisé au service du maintien d’une idéologie de la croissance. Thomas Zanetti indique ainsi, dans la notice « industrialisme », que « l’anthropocène est […] convoqué pour démontrer la capacité humaine à contrôler la nature, sans remettre en cause les logiques fondamentales d’accumulation intrinsèques au capitalisme » (p. 479).
Le dictionnaire, depuis « abeille » jusqu’à « zone humide », offre des ressources classées selon huit entrées : acteurs et relations de pouvoir (« lobbies », « néolibéralisation de la nature », « ONG », « réfugié », « savoir autochtone », etc.) ; activités et aménagements anthropiques (« aéroport », « agriculture », « énergie », « extractivisme », « lithium », « pêche », « ressource », etc.) ; enjeux politiques, économiques et sociaux (« agrobusiness », « alimentation », « aménagement du territoire », « santé », etc.) ; faune emblématique (« baleine », « chasse », « loup », « porc », etc.) ; lieux et espaces emblématiques (« Amazonie », « Antarctique », « Arcadie », « Fukushima », « Sahel », « Sibérie », « Xynthia », etc.) ; mécanismes bio-géo-physiques (« biogéographie », « changement et dérèglement climatiques », « désertification », « montée des eaux », etc.) ; modèles et référentiels de pensée (« adaptation », « catastrophisme », « écologisme », « résilience », « transhumanisme », etc.) ; qualifier le vivant (« agrobiodiversité », « ensauvagement », « extinction des espèces », « patrimoine naturel », etc.). 189 auteurs ont contribué à la rédaction du dictionnaire, ce qui implique parfois quelques redites. On regrette par exemple que les entrées « île », « insularisme » et « insularité et biogéographie » manipulent des raisonnements et des concepts similaires : ces notices mobilisent ainsi toutes la théorie de la biogéographie insulaire, mais aussi la critique du raisonnement insulariste et de l’ouvrage Effondrement de Jared Diamond (2005).
La lecture du dictionnaire montre combien le regard du géographe est précieux pour penser la transformation du système Terre, notamment par une réflexion poussée sur les échelles. La notice « catastrophisme » se positionne notamment sur le fait que « la problématique nucléaire ou environnementale est certes mondiale mais inégalement locale » (p. 153). La notice « énergie – société et climat » souligne que « les échelles géographiques ne sont plus envisagées comme données a priori et verticalement emboîtées dans des hiérarchies immuables. Elles sont définies comme des espaces socialement construits, considérés comme pertinents à un moment donné pour élaborer et mettre en œuvre des stratégies » (p. 349). De nombreux exemples localisés et précis sont choisis : le mouvement du Buen Vivir est décliné dans ses différentes facettes en Équateur et en Bolivie ; plusieurs zones à défendre (ZAD) sont analysées, à Notre-Dame-des-Landes, dans le Tarn, ou près de lieux choisis pour devenir des réceptacles des déchets de l’industrie nucléaire, à Bure par exemple. Parcourir le dictionnaire permet de saisir l’irréductibilité des lieux et des contextes, en mettant en valeur l’approche géographique pour penser la transformation des milieux.
Faire la synthèse de cette somme d’informations n’est pas tâche aisée. J’assume volontiers ne pas avoir lu les 330 notices et propose ici quelques pistes de réflexion qui n’épuisent pas la pluralité et la richesse des questions soulevées par l’ouvrage. L’auteure assume également avoir lu en priorité les notices qui semblaient centrales (pour n’en citer que quelques-unes : « anthropocène », « changement et dérèglement climatiques », « climatoscepticisme », « environnement »), mais aussi les notices liées à ses thématiques de recherche et à ses objets de curiosité (les questions énergétiques, la problématique nucléaire, le fonctionnement du système industriel, les savoirs environnementaux), ce qui constitue un biais certain des analyses.
Anthropocène et savoirs environnementaux
La première piste de réflexion proposée porte sur les différents types de savoirs environnementaux mobilisés pour s’interroger sur les impacts des sociétés sur les milieux. Un des apports majeurs du dictionnaire me semble être les questionnements liés à l’information géographique produite pour penser les changements environnementaux. À plusieurs reprises, l’ouvrage s’engage dans une pertinente remise en cause de la quantification des savoirs environnementaux et du recours aux chiffres pour appréhender les transformations du système Terre. La réflexion sur la mesure de celles-ci et la critique des indicateurs chiffrés sont posées dès l’introduction : « la fétichisation des chiffres s’inscrit dans un paradigme néolibéral qui fait de l’évaluation quantifiée l’alpha et l’oméga des conduites sociales » (p. XII). Plusieurs rapports institutionnels sont épinglés pour leur vision cybernéticienne : « l’appétence pour la systémisation mathématique et statistique, repérable depuis Malthus, voire auparavant, jusqu’au rapport Meadows (1972) du Club de Rome, évolue dans un contexte général de quantification et de cybernétisation des sciences » (« démographie », p. 238). Les notices « Big Data environnemental » et « information environnementale », toutes deux rédigées par Pierre Gautreau, font état de la massification des données environnementales, engagée au début du XXIe siècle, et qui a pour objectif de piloter le système Terre et de marginaliser peu à peu les savoirs vernaculaires et leur légitimité politique. Les valeurs esthétiques, sensibles, religieuses des savoirs sont reléguées au second plan par une demande croissante d’objectivation des caractéristiques de la nature. Ce mouvement conjoint de massification et de quantification des données environnementales est indissociable de l’affirmation de l’échelle globale comme étant la plus pertinente pour analyser la relation des êtres humains avec la Terre, alors même que les géographes tiennent davantage aux emboîtements d’échelles pour appréhender la diversité des rapports au monde et à l’environnement. En outre, pour certains auteurs, la quantification des données environnementales contribue à la marchandisation néolibérale du vivant et ouvre la voie à la fixation de valeurs monétaires aux éléments naturels, afin de les échanger sur des marchés.
À l’opposé, le dictionnaire valorise les savoirs non scientifiques à l’exemple des sources pertinentes de connaissances environnementales, notamment par le biais de la notice « savoir autochtone ». Ces savoirs sont définis comme construits hors du cadre scientifique, souvent peu formalisés et ancrés dans un territoire identifiable. Néanmoins, le collectif Cynorhodon met en garde les lecteurs contre une trop forte valorisation de ces derniers : « il ne faut pas pour autant mettre sur un piédestal les vertus des savoirs “ancestraux” ou “indigènes”, ne serait-ce que parce que nous sommes tous des indigènes de l’Univers » (p. XIII). Ces savoirs, par manque de théorisation, restent difficilement communicables aux membres extérieurs du groupe au sein duquel ils s’élaborent. Comment, dès lors, les rendre intelligibles pour construire une information environnementale robuste qui puisse être discutée dans l’espace public ? La confrontation des notices « Big Data environnemental », « information environnementale », « savoir autochtone » offre ainsi de stimulantes pistes de réflexion.
L’ouvrage a également le mérite de se détacher du prisme de la référence culturelle occidentale dominante : en témoignent certains passages sur l’interprétation de l’accident nucléaire de Fukushima en 2011 perçu par des penseurs et écrivains japonais. Les questions de transmission des savoirs liés à l’environnement sont aussi abordées, par exemple par la notice « éducation à l’environnement » (rédigée par Christine Vergnolle-Mainar). Celle-ci souligne que persiste, dans les écoles, une valorisation de réponses techniques normées, centrées sur des actions individuelles de nature réparatrice (trier ses déchets, éteindre les lumières), sans inciter les enfants ou adultes à engager une remise en cause politique profonde.
Dans cette optique de mise en valeur d’une pluralité de savoirs environnementaux, la faible présence de géographes-physiciens parmi les auteurs des notices est toutefois regrettable. Leur intégration plus poussée aurait pu permettre d’être parfois plus précis sur la matérialité des dégradations environnementales en cours et de développer des positions plus rigoureuses sur l’analyse des processus biologiques, chimiques et physiques qui structurent les milieux (Dufour et Lespez, 2019). Les chercheurs en géosciences ne seraient sans doute pas ravis de lire qu’ils appartiennent au « champ aride des sciences de la Terre » (p. 58). Les apports de la Critical physical geography, en voie de structuration depuis les années 2010, qui témoignent d’une volonté de penser les enjeux sociaux tout en conservant un discours sur la matérialité du monde par le biais de la maîtrise des outils de mesure des processus biophysiques, ne sont pas évoqués.
L’anthropocène, le nucléaire et la technique
L’ouvrage assume une position critique sur les questions nucléaires. Plusieurs notices font explicitement le lien entre anthropocène et énergie nucléaire : « la dissémination dans l’environnement de radio-isotopes entièrement créés par l’être humain, comme le césium 137 produit dans les réacteurs nucléaires ou lors de l’explosion d’une bombe atomique, constitue un marqueur important de l’anthropocène » (« industrie nucléaire », signée Teva Meyer, p. 597). La notice « énergie – fossile et nucléaire » se positionne sur l’étendue des questions que soulève le recours à l’industrie nucléaire : sécurité des centrales, stockage des déchets radioactifs, démantèlement des centrales en fin d’activité. Le dictionnaire est en revanche plus frileux sur les sujets plus généraux de technique et d’industrie. On peut ainsi s’étonner que le dictionnaire ne comporte pas d’entrée « innovation » ni « progrès technique », que la notice « technique » reste largement traitée d’un point de vue historique, en retraçant l’histoire du lien entre technique et nature, et que le choix ait été fait de rédiger une notice « industrialisme » sans la mettre en regard d’une notice « industrie ». L’entrée « industrialisme » explicite la pensée de Saint-Simon, mais ne fait aucun écho aux voies anti-industrielles contemporaines. Elle stipule que « l’emballement industrialiste a eu un rôle prépondérant dans la dégradation de l’environnement, le dérèglement climatique et la réduction de la biodiversité » (p. 479) : est-ce vraiment un « emballement » du système industriel qui est à déplorer, ou bien ne peut-on pas juger que le projet industriel porte en lui-même d’emblée la responsabilité de ces dégradations ? Cette notice fait la part belle aux analyses des idéologies et leur fait endosser une lourde responsabilité, comme si c’étaient bien ces idéologies qui avaient été motrices dans le développement industriel. Dans une perspective plus matérialiste, n’est-ce pas plutôt le système industriel dans sa globalité qui porte cette responsabilité, système dans lequel les idéologies ont un rôle moindre ?
Le dictionnaire n’explore pas en profondeur les voies critiques face aux innovations techniques. Il ne fait pas état des controverses sur la démocratie technique, entre partisans d’une régulation et d’une démocratisation des choix technologiques (Callon, Lascoumes et Barthe, 2001) et dénonciateurs des contradictions entre trajectoires technologiques, démocratie et possibilités d’émancipation. Ne pas évoquer ces derniers (groupe de l’Encyclopédie des Nuisances autour de Jaime Semprun et René Riesel [2008] ; groupe grenoblois de Pièces et Main d’œuvre, qui critique l’emprise des technologies sur nos vies quotidiennes et leur impact environnemental [2006 ; 2009 ; PMO et Gaillard, 2012] ; groupe Oblomoff qui souligne que le déploiement de la science est allé de pair avec le projet d’une maîtrise technique généralisée du monde [2009]) montre quels choix ont été faits par les membres du collectif Cynorhodon, peu enclins sans doute à formuler une critique plus ferme à l’égard de la société industrielle.
Malaise malthusien
Plusieurs entrées du dictionnaire engagent des réflexions démographiques. Le lien entre enjeux environnementaux et enjeux démographiques est presque exclusivement pris en charge par Philippe Pelletier, auteur de plus d’une cinquantaine de notices. L’approche développée peut se résumer en quelques points. Pelletier s’efforce de mettre en lumière des relations entre pensée écologiste et théorie malthusienne. Si l’apport de Thomas Malthus (1766-1834) permet de développer des réflexions sur les rapports entre population et ressources, Pelletier se positionne dans le débat en insistant sur le fait que Malthus minimise plusieurs facteurs influant sur les dynamiques démographiques comme les migrations, le commerce, les échanges. Il met ensuite en valeur, au sein de plusieurs notices, l’héritage malthusien au moment de la structuration des politiques environnementales après 1945. Ainsi, les États-Unis se prononcent, à cette époque, en faveur de politiques de protection des espèces et de régulation démographique. Pelletier cite notamment Thomas Robertson (2012) selon lequel « le moment malthusien » post-Seconde Guerre mondiale marque « la naissance de l’environnementalisme américain » (cité p. 523). Puis il va encore plus loin en citant André Pichot (2009) pour qui « le militantisme eugéniste a trouvé à s’occuper en s’orientant vers une nouvelle forme de malthusianisme : le contrôle de la population mondiale » (cité p. 523). Des notices comme « social-darwinisme », « malthusianisme », « démographie » ou encore « rapport Meadows » se veulent démonstratrices de filiations entre Darwin, Malthus et les « militants de l’écologisme » (p. 239). Elles font le lien entre prise de conscience de la forte croissance démographique après 1945, montée en puissance de la pensée écologiste et glissement vers une forme de darwinisme, voire d’eugénisme : puisque trop de monde pollue la planète, opter pour des stratégies de contrôle de la croissance démographique permettrait in fine de polluer moins.
Si les filiations entre théoriciens des questions démographiques et pensée écologiste sont d’un intérêt certain, la réappropriation de ces théories par les militants contemporains n’est que très peu abordée. Pelletier pose ainsi que « les affirmations démographiques, souvent outrancières et relevant du catastrophisme, sont généralement reprises sans discernement par les militants de l’écologisme » (p.239), sans que l’on sache réellement qui sont concrètement ces militants. Si les acteurs agissant pour la gouvernance mondiale des questions environnementales sont finement catégorisés (voir par exemple la notice « GIEC/IPCC »), de même, une analyse plus approfondie des argumentaires militants qui auraient repris à leur compte les théories malthusiennes aurait été souhaitable. En outre, l’auteur semble rejeter toute approche critique sur les enjeux démographiques et leurs conséquences en matière d’occupation spatiale du système Terre : l’augmentation de la population humaine n’est pas considérée comme une donnée sur laquelle il serait pertinent de réfléchir. Dans la notice « rapport Meadows » rédigée par David Blanchon et Philippe Pelletier, il est ainsi mentionné que « le rapport Meadows annonce que l’humanité ne pourra pas cultiver au-delà de 3,2 milliards d’hectares, alors qu’en réalité, l’humanité a augmenté ses surfaces cultivées d’environ un quart, et sa nourriture d’autant – sans même introduire la question des gains de productivité » (p. 692). Doit-on réellement se féliciter de l’extension continue des terres mises en agriculture ? À lire ces notices, on comprend combien Pelletier souhaite marquer le dictionnaire de son empreinte, critique envers la pensée écologiste telle qu’elle s’est structurée en 1945 aux États-Unis.
En définitive, quelle est la portée politique du Dictionnaire critique de l’anthropocène ? Répondre à cette question reste difficile puisque, dès l’introduction, les membres du groupe Cynorhodon expriment un refus de toute dimension prescriptive, se donnant l’objectif de « se saisir de la valeur heuristique du concept d’anthropocène, en laissant à chacune et à chacun le soin de se prononcer sur le fond et à partir des éléments fournis » (p. XII). Certains auteurs font le choix d’une posture relativement neutre quant aux enjeux politiques de l’anthropocène, d’autres assument une posture plus engagée : telle est par exemple la différence entre les notices « conflit environnemental » et « lutte environnementale ». En effet, cette dernière soulève les enjeux posés par les mouvements critiques anticapitalistes et les lie au concept d’anthropocène. On peut toutefois s’interroger sur la portée de l’utilisation de ce concept par les géographes. En introduction, le groupe Cynorhodon montre que la transformation des milieux est analysée par plusieurs récits consécutifs. Le premier, assimilé à la modernité et au progrès d’origine occidentale, a consacré la maîtrise croissante de l’humanité sur la nature. Le deuxième, élaboré au cours de la seconde moitié du XXe siècle, a souligné les limites du précédent, en proposant des solutions au nom d’un impératif écologique. Les géographes se sont successivement emparés de ces deux récits, en reprenant à leur compte la notion de « développement » puis celle de « développement durable ». Le concept d’anthropocène, sur lequel se fonde le troisième récit, ne correspond-il pas, au fond, à une nouvelle forme de suivisme des géographes ? Ces questionnements émergent dans certaines notices : « la rapidité de la diffusion de l’anthropocène au sein des réflexions pédagogiques invite à un parallèle avec une notion antérieure comme le “développement durable” » (notice « Anthropocène – en géographie française », rédigée par Véronique Fourault, p. 63). Jusqu’où la réappropriation de nouveaux concepts destinés à détruire les précédents (« développement durable », « résilience », etc.) est-elle pertinente ? Celui d’anthropocène reste au fond issu d’un raisonnement systémique, pensé à l’échelle globale, typique des représentations cybernéticiennes de l’être vivant et du système Terre.
Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz, dans leur ouvrage L’Événement anthropocène. La Terre, l’histoire et nous (2013), sont allés plus loin dans leur déconstruction du récit officiel de l’anthropocène, selon lequel l’espèce humaine aurait, par le passé, détruit inconsciemment le système Terre avant de prendre conscience des conséquences globales de l’agir humain grâce aux études scientifiques. Les deux auteurs montrent que « ce récit d’éveil est une fable. L’opposition entre un passé aveugle et un présent clairvoyant, outre qu’elle est historiquement fausse, dépolitise l’histoire longue de l’anthropocène » (2003, p. 11) et combien la période qui s’ouvre avec la révolution industrielle est celle d’une désinhibition croissance par rapport aux dégâts de l’industrie. Ces désinhibitions passées peuvent être mises en parallèle des discours contemporains sur l’anthropocène. Reprendre à son compte le concept d’anthropocène, même avec une lecture critique, ne procède-t-il pas de cette tentation d’analyser la Terre comme une machine ?
Bibliographie
Bonneuil Christophe, Fressoz Jean-Baptiste, L’Événement anthropocène. La Terre, l’histoire et nous, Paris, Éditions du Seuil, 2013.
Callon Michel, Lascoumes Pierre, Barthe Yannick, Agir dans un monde incertain. Essai sur la démocratie technique. Paris, Le Seuil, 2011.
Dufour Simon, Lespez Laurent. « Les approches naturalistes en géographie, vers un renouveau réflexif autour de la notion de nature ? », Bulletin de l’association des géographes français, no 2, 2019, p. 319-343.
Oblomoff (groupe), Un futur sans avenir. Pourquoi il ne faut pas sauver la recherche scientifique, Bagnolet, L’Échappée, 2009.
Pièces et main d’œuvre (PMO), Nanotechnologies/maxiservitudes, Paris, L’Esprit frappeur, 2006.
Pièces et main d’œuvre (PMO), Terreur et Possession : enquête sur la police des populations à l’ère technologique. Montreuil, L’Échappée, 2008.
Pièces et Main d’œuvre (PMO), Gaillard Frédéric, Sous le soleil de l’innovation, rien que du nouveau. Montreuil, L’Échappée, 2012.
Riesel René et Semprun Jaime, Catastrophisme, administration du désastre et soumission durable. Paris, Éditions de l’Encyclopédie des Nuisances, 2008.
Robertson Thomas, The Malthusian Moment: Global Population Growth and the Birth of American Environnementalism, New Brunswick, Rutgers University Press, 2012.

