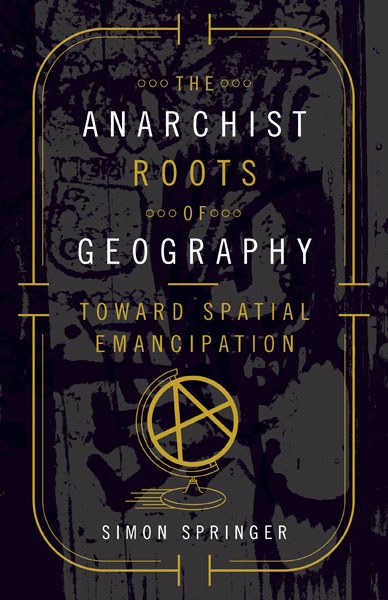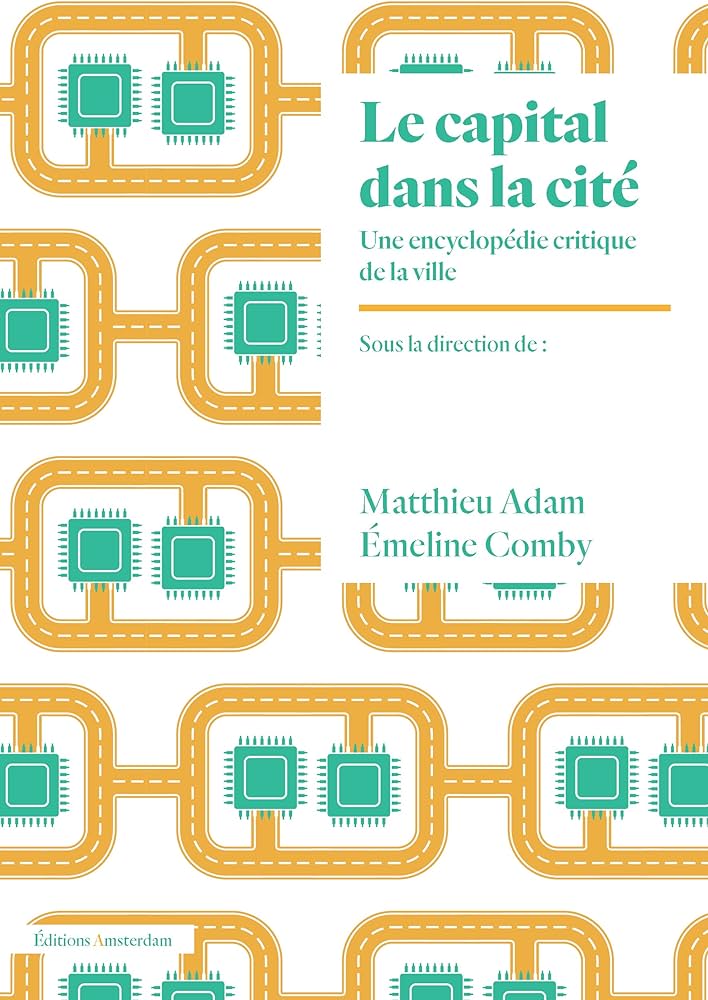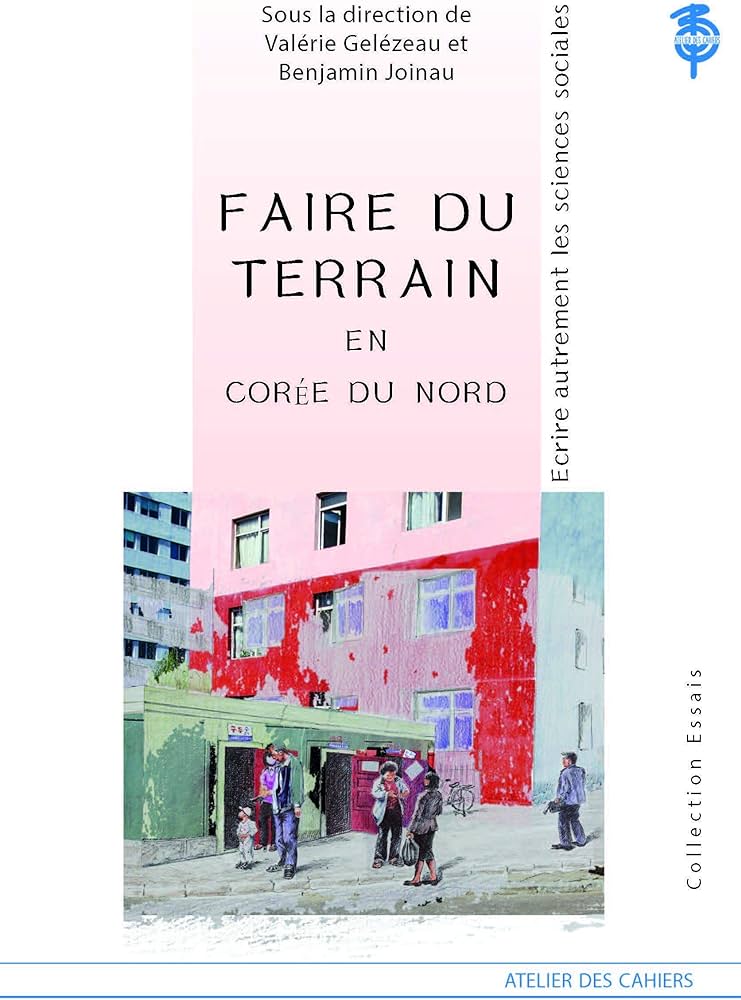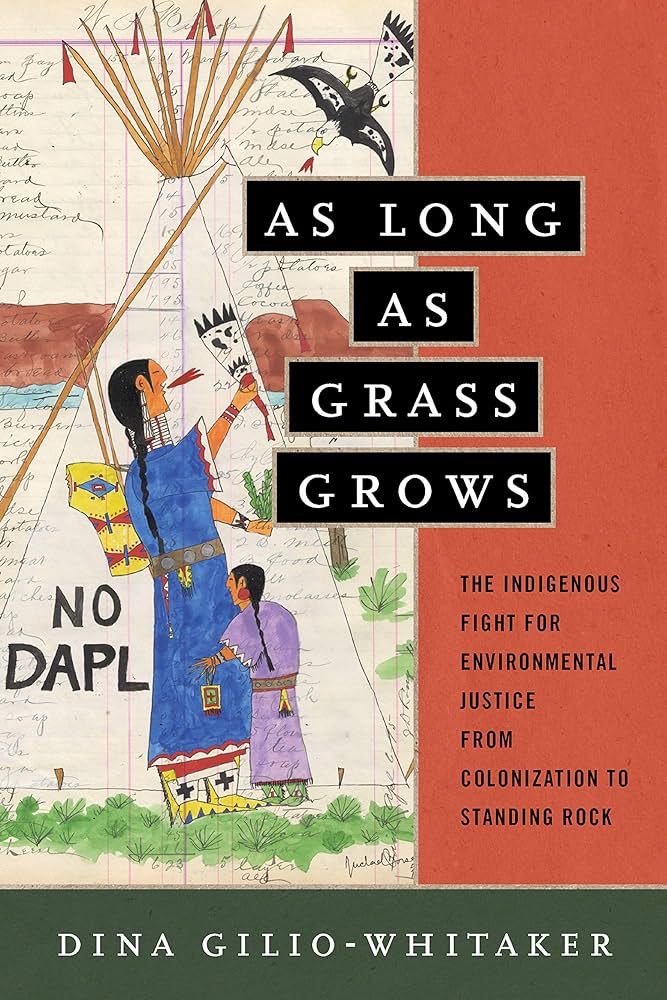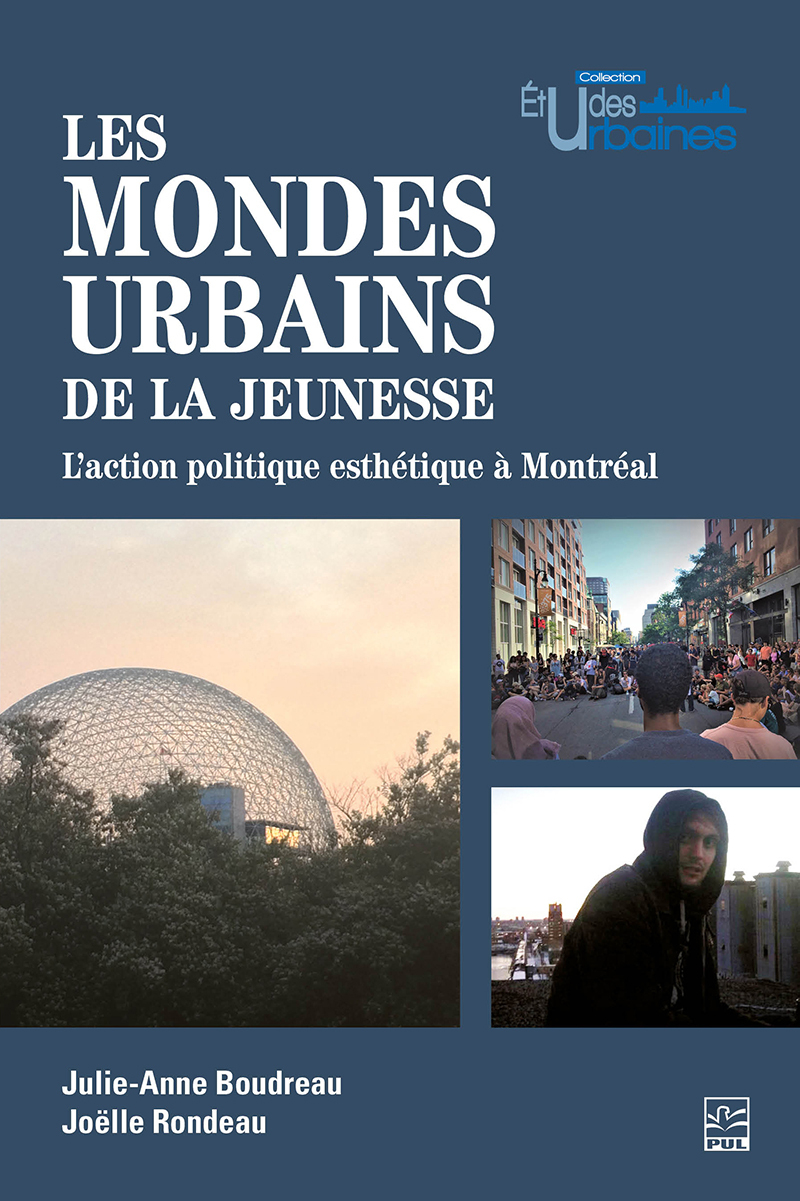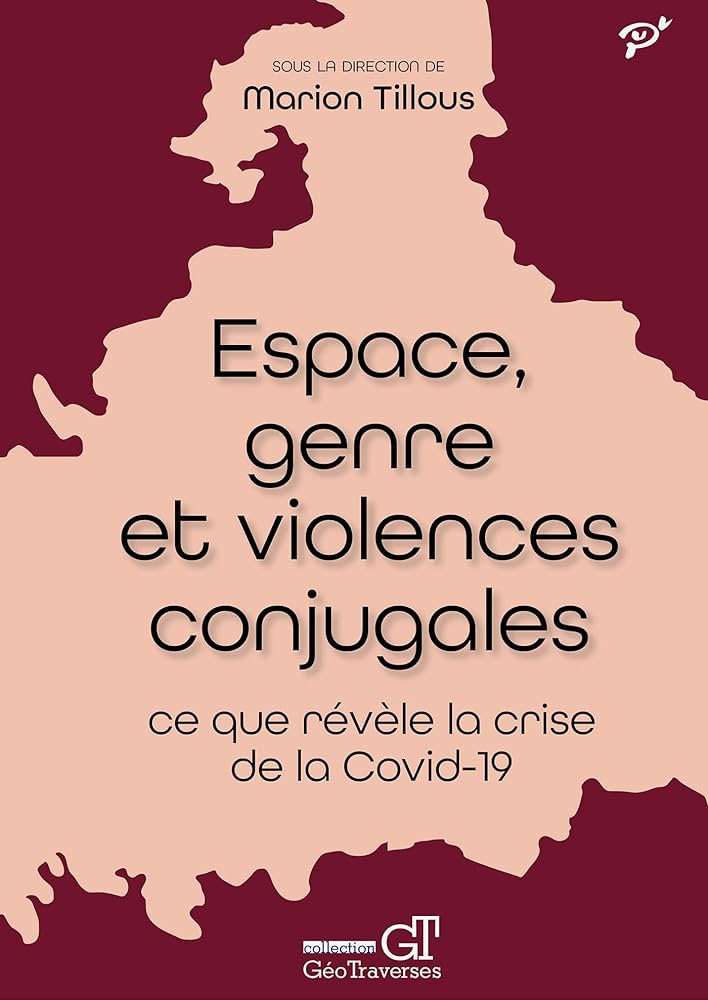
Marion Tillous (dir.)
Espace, genre et violences conjugales : ce que révèle la crise du Covid-19
Presses universitaires de Vincennes, 2022, 159 p. | commenté par : Tahera Bilger
L’ouvrage Espace, genre et violences conjugales : ce que révèle la crise du Covid-19 est une synthèse des résultats de la recherche ANR « Spatialité des violences conjugales & Covid-19 » coordonnée par la géographe Marion Tillous. Cette enquête s’intéresse aux « conséquences des politiques spatiales sur les violences conjugales pendant la période de mars 2020 à mars 2021 » (p. 19), et propose une approche géographique des violences dans le couple, depuis une posture de géographie féministe. Dans un contexte où les politiques publiques menées pendant la crise sanitaire ont eu en commun la limitation des pratiques spatiales, cette approche permet de saisir la spatialité des violences domestiques, une dimension encore peu présente dans le débat public.
Menée dans l’année suivant le confinement, cette recherche vient enrichir les enquêtes menées à l’échelle nationale durant la crise sanitaire : l’enquête Coconel (Logements et conditions de vie), menée par l’INED, et le programme ANR VICO (Vie quotidienne en confinement) coordonné par Pierre Mercklé (Pacte)[1]. Elle privilégie quant à elle une approche locale en s’ancrant dans deux territoires, la Haute-Garonne et l’Isère : ces départements ont en commun un certain dynamisme dans leurs politiques de lutte contre les violences, et rassemblent des types d’espaces variés (urbains, périurbains, ruraux, montagneux, etc.) permettant de mettre en évidence des disparités sociospatiales.
L’introduction, rédigée par Marion Tillous, est principalement consacrée à la présentation du cadre théorique de la recherche, et démontre l’intérêt d’une approche de géographie féministe pour appréhender les violences conjugales pendant le confinement. En s’appuyant sur les travaux d’Eva San Martin (par ailleurs co-autrice de l’ouvrage), elle montre que la dimension spatiale des violences conjugales est à la fois le symptôme et l’instrument de ces violences : celles-ci ne se limitent pas à l’intime, mais se déploient à travers des échelles multiples. À partir de ce point de départ, l’introduction s’attache à relier le caractère structurel et la spatialité des violences de genre.
À travers une synthèse des théories féministes matérialistes, Marion Tillous rappelle que la violence, physique et psychologique, est l’une des conditions du maintien du rapport de domination patriarcal. Pour illustrer la spatialité des violences de genre, l’autrice mobilise le concept de continuum des violences, qui met l’accent sur la dimension structurelle des violences sexistes et sexuelles et permet de penser ensemble les violences vécues par les femmes dans tous les types d’espace. Elle participe ainsi à la critique de la division public-privé, un axe majeur des travaux de la géographie féministe.
Des pratiques spatiales marquées par les inégalités de genre
Le premier chapitre, rédigé par Julie Bulteau, Esté R. Torres et Marion Tillous, est consacré à l’influence du genre et de l’organisation familiale sur les pratiques spatiales quotidiennes, et s’intéresse plus particulièrement au caractère genré des mobilités. Le chapitre commence par revenir à l’espace privé, pour approfondir l’idée du couple monogamique et de la famille hétérosexuelle comme institutions sociospatiales, dont la naissance est concomitante à celle de l’État moderne et imbriquée dans les évolutions du capitalisme. L’espace domestique est donc une « représentation matérielle de l’ordre social ». De fait, l’évolution des rapports de genre n’a eu que peu d’influence sur les inégalités de répartition du travail domestique et parental : 71 % des tâches ménagères et 65 % des tâches parentales étaient encore assurées par les femmes en 2010[2], une légère diminution s’expliquant principalement par une délégation croissante de ces tâches à des femmes en situation de domination dans les rapports de classe et de race. Les auteur·ice·s rappellent que le confinement a accentué cette division sexuelle du travail domestique et parental, la charge de travail supplémentaire ayant été assumée principalement par les femmes. Ainsi, les rapports de domination genrés ont paradoxalement réduit la possibilité pour les femmes d’accéder, au sein d’un espace privé auxquelles elles sont pourtant historiquement assignées, à une véritable « privacité ».
Les auteur·ice·s en viennent ensuite à la question des mobilités, et tentent de dégager les ressorts des schémas de déplacement différenciés entre femmes et hommes avant le confinement. Les femmes ont une fréquence de déplacement plus importante que les hommes, mais parcourent une distance plus faible, au sein d’un périmètre réduit : cette différence s’explique par la part plus importante des déplacements non liés au travail et liés à la division sexuelle du travail et aux tâches de care. Au contraire, la période du confinement a été celle d’un ralentissement significatif des mobilités et de la tendance à l’égalisation : la suite du chapitre exploite les résultats du questionnaire administré à 3 012 personnes en Occitanie et en Auvergne-Rhône-Alpes entre janvier et février 2021. Il en ressort que la mobilité des femmes a été particulièrement affectée, tant en termes de durée que de distance, l’espace public se trouvant « caricaturalement masculinisé en même temps qu’il s’est vidé » (p. 45). Les femmes en couple sans enfants, les travailleur·euse·s « essentiel·le·s » et les personnes habitant en zone rurale ont été davantage mobiles. Au contraire, le fait d’avoir des enfants est un facteur majeur de réduction des déplacements, les femmes étant plus nombreuses à les prendre en charge à la maison. La forte réduction de l’usage des transports collectifs a particulièrement impacté la mobilité des femmes, en particulier les plus modestes. Après le confinement, les auteur·ice·s observent sur la période allant de janvier à février 2021 un regain de mobilité. Les déplacements des femmes sont redevenus supérieurs en nombre à ceux des hommes, sans toutefois atteindre leur niveau préconfinement.
Des logiques de contrôle spatial accentuées par le confinement
Rédigé par Eva San Martin et Marion Tillous, le deuxième chapitre exploite les résultats de 25 entretiens menés avec des femmes vivant ou ayant vécu des violences conjugales, ainsi que les travaux antérieurs des autrices, dont la thèse de doctorat d’Eva San Martin. Ce chapitre s’appuie sur le concept de contrôle coercitif, tel qu’il est théorisé par Evan Stark. Il présente la spécificité, dans le cas des violences conjugales, de s’appuyer sur une connaissance intime de la victime, produisant des formes de persécution évolutives et inédites, dont la violence physique n’est qu’une des dimensions. Les autrices articulent à ce concept celui de violence localisante, qui s’attaque à la place du corps dans l’espace. Le chapitre trace ensuite les continuités entre les ressorts du contrôle spatial à l’extérieur et à l’intérieur du domicile. De manière générale, les femmes victimes de violences conjugales sont victimes de « déprise spatiale » : l’homme violent prend progressivement toute la place, les femmes victimes vivant un processus de « rétrécissement progressif de l’étendue de l’espace vécu » (p. 59), émaillé de tactiques d’adaptation. À l’extérieur, le contrôle peut prendre une dimension directe à travers l’instauration d’un cadre strict définissant les déplacements autorisés, une interdiction de sortir seule, ou encore une limitation de l’accès aux véhicules. Le contrôle coercitif repose également sur différentes formes de surveillance spatiale, notamment à travers l’utilisation d’outils de géolocalisation. Enfin, le contrôle coercitif peut aussi se traduire, indirectement, par une autocensure des victimes accélérant leur isolement social et la perte de leurs « compétences spatiales ».
À l’échelle du domicile et de l’intime, la déprise spatiale se traduit par « une disparition de l’espace personnel au sein même de l’espace privé » (p. 70). Les logiques d’évitement mises en place par les victimes conduisent à une situation de déterritorialisation où l’habiter, au sens d’exister dans l’espace, devient impossible. Le contrôle coercitif se déplace jusqu’à l’échelle du corps et des objets personnels, à travers la destruction des affaires personnelles et des souvenirs, et les injonctions liées aux vêtements ou à la gestuelle. Les femmes victimes déploient des stratégies multiples pour tenter de conserver un espace à soi, mais les moyens du contrôle coercitif étant en perpétuelle évolution, les zones de sécurité ont tendance à se faire de plus en plus abstraites et mentales, et de moins en moins matérielles à mesure que s’accentue la déprise spatiale.
Le chapitre aborde ensuite l’impact du confinement et de la crise sanitaire sur les logiques spatiales des violences conjugales. Le contrôle spatial gouvernemental redouble le contrôle conjugal, chaque sortie devant être justifiée. Surtout, les victimes se retrouvent « sans coulisses », privées de possibilités d’échapper au conjoint violent et d’espaces de privacité. Les proches, avec lesquels les liens se sont dématérialisés, ne peuvent plus constituer des refuges temporaires. Quitter le domicile reste possible : pour plusieurs des femmes rencontrées, le confinement a pu accélérer la décision de partir, les voisin·e·s et les habitant·e·s du quartier faisant alors souvent figure de personnes ressources. Les femmes déjà séparées de leur conjoint ont connu une situation particulière, le confinement réduisant la possibilité pour les agresseurs de rentrer en contact avec leur victime et produisant une « relative bulle protectrice » (p. 88). Toutefois, les agresseurs ayant tendance à ne pas respecter la loi, les victimes n’ont pas pu se sentir totalement à l’abri des violences.
L’accompagnement des victimes au défi de la distance
Le troisième et dernier chapitre, rédigé par Pauline Delage, Eva San Martin et Marion Tillous, déplace la focale pour s’intéresser à l’impact du confinement sur le travail des professionnel·le·s de l’accompagnement des victimes de violences conjugales. Cinquante-six associations ou institutions intervenant dans les domaines institutionnels, juridique et judiciaire, sanitaire et social ont été interrogées dans les deux départements d’enquête. Dans « un contexte national favorable à la reconnaissance des violences et à la mobilisation des acteurs » (p. 97), notamment suite au Grenelle contre les violences conjugales tenu en 2019, la forte médiatisation de la question a engendré une véritable prise de conscience. La crise du Covid-19 est alors l’occasion de concrétiser la mise en œuvre des nouveaux dispositifs issus du Grenelle. Un effort important est fait pour permettre d’accueillir les signalements, à travers le lancement de la plateforme « Arrêtons les violences », la mise en place de « points info » par la gendarmerie dans les supermarchés et les pharmacies, et des moyens d’hébergement exceptionnels sont mis en place en urgence. Pour autant, les mises à l’abri ne s’accompagnent pas systématiquement d’un accompagnement social, et la fin du confinement signe le retour au statu quo ante. Parallèlement, les politiques publiques ciblent également l’éviction des auteurs de violences, grâce à une plateforme d’hébergement en partenariat avec la chaîne hôtelière Accor. Si les dispositifs de signalement et l’accueil des victimes se sont améliorés, la difficile instruction des plaintes et le ralentissement des procédures judiciaires ont parfois compromis les tentatives de fuite. De plus, l’accès à ces services reste marqué par de fortes disparités socioterritoriales, les territoires ruraux et montagneux étant moins bien dotés en stands de signalement. Enfin, le millefeuille administratif et territorial a pu compliquer les actions, notamment dans les zones périurbaines. Pour autant, les autrices relèvent une grande solidarité entre les acteurs, qui cherchent à rester en lien et à tisser de nouvelles relations, mais le plus souvent à travers des initiatives disparates, sans pilotage de l’action publique.
Pour les femmes déjà prises en charge par les associations d’aide aux victimes, la question qui se pose est celle du maintien du lien d’accompagnement : la nécessité de passer à un accompagnement à distance rompt les conditions habituelles de la relation d’écoute. L’autonomie des professionnelles est alors à double tranchant ; la plupart doivent s’adapter au pied levé et font état d’un fort sentiment d’isolement, voire d’abandon, mais font aussi preuve de solidarité et d’entraide. L’accompagnement a tendance à déborder des horaires de travail, ce qui a pu engendrer des difficultés pour les accompagnantes cumulant télétravail et travail domestique. Pour les femmes résidant en hébergement d’urgence, la crise a produit une grande stabilité, toute entrée ou sortie étant provisoirement suspendue. Si des tensions ont pu apparaître entre les résidentes, c’est là aussi l’entraide qui a semblé prévaloir, certains centres d’hébergement se transformant en « grandes colocations ». Les accompagnantes, contraintes d’adopter une posture de contrôle social pour faire respecter les règles de déplacements et de distanciation sociale, ont parfois difficilement vécu ce changement de rôle temporaire.
En conclusion, les auteur·ice·s avancent que la crise sanitaire n’a en réalité pas modifié en nature les rapports sociaux de genre, de classe ou de race, mais les a au contraire renforcés, de même que les disparités territoriales. Cet ouvrage, clair et synthétique, est une réussite par son habileté à construire une argumentation faite d’allers-retours entre les échelles et battant en brèche la division public-privé. Il remet en question l’idée d’un événement exceptionnel pour pointer la permanence des rapports de domination, et la fragilité des évolutions vers plus d’égalité. En faisant une large place aux extraits d’entretien, il donne une épaisseur particulière aux situations décrites, et donne voix aux témoignages des victimes, éclairés par une solide base théorique. L’approche de géographie féministe proposée par les auteur·ice·s se distingue par sa rigueur et propose une contribution pertinente à la compréhension de la spatialité des rapports de domination.
[1] Ces deux enquêtes ont fait l’objet de publications : pour les résultats de l’enquête Coconel, voir Anne Lambert, Joanie Cayouette-Remblière (éd.), 2021, L’explosion des inégalités : classes, genre et générations face à la crise sanitaire, La Tour d’Aigues, Éditions de l’Aube, 2021. Pour les résultats du programme VICO, voir Nicolas Mariot et al., Personne ne bouge : une enquête sur le confinement du printemps 2020, UGA Éditions.
[2] D’après la dernière enquête « Emploi du temps » de l’Insee.
More