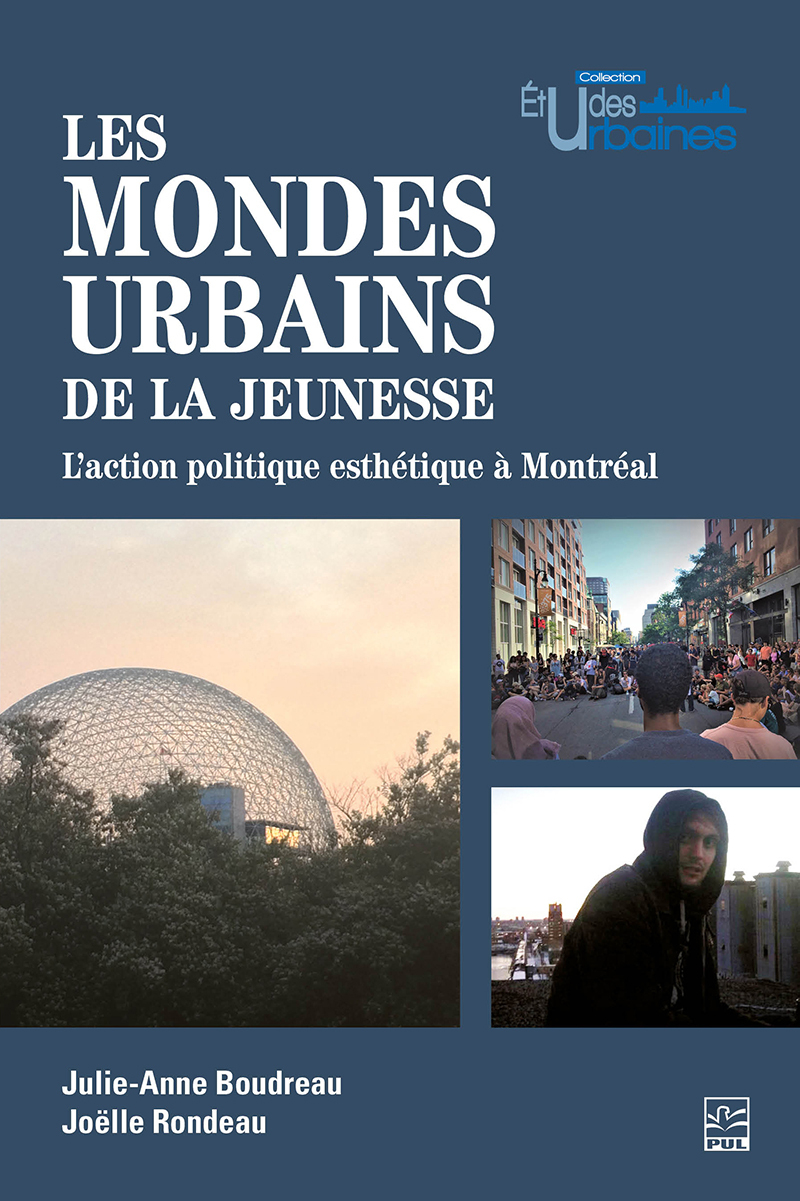
Julie-Anne Boudreau, Joëlle Rondeau
Les mondes urbains de la jeunesse. L’action politique esthétique à Montréal
Les presses de l’université Laval, 2021, 316 p. | commenté par : Claudette Lafaye
Tournant résolument le dos à une conception institutionnelle du politique, cet ouvrage appréhende l’action politique par le bas, par les acteurs qui la produisent, la transforment et lui donnent sens dans des mondes urbains inégalitaires où l’État peine à assurer ses missions de régulation. Les autrices nous convient à les suivre dans l’attention qu’elles portent à un ensemble de gestes politiques non décryptés comme tels que sont les slams, les danses ou les vidéos de jeunes résidents racisés des quartiers populaires de Montréal. Elles nous invitent également à nous rendre sensibles à l’intensité esthétique du « printemps érable » de 2012 et à ses concerts de casseroles. Elles nous font pénétrer dans le petit monde de l’agriculture urbaine montréalaise où humains et non-humains collaborent pour produire des espaces urbains plus écoresponsables. Nous les accompagnons enfin auprès de preneurs de risques volontaires (skateurs, slackeurs, graffeurs, adeptes du dumpster diving…) dont les activités rendent visibles les normes sociales ordinaires.
L’ouvrage, qui compile les résultats de plusieurs recherches collectives menées durant la décennie 2010-2020 au sein du laboratoire Ville et espaces politiques (Vespa)[1], défend la thèse que, dans les mondes urbains contemporains, l’esthétique constitue une nouvelle dimension de l’action politique. L’engagement esthétique est problématisé comme relevant à la fois de l’expérience sensorielle et du domaine socialement et culturellement construit du jugement (p. 21). C’est toutefois l’expérience sensible qui est privilégiée comme l’atteste l’importance du fil conducteur de la séduction et de l’attraction (entre humains, entre humains et non-humains, entre les corps en mouvement et les artefacts matériels qui peuplent l’espace urbanisé des villes mondialisées) qui relie analytiquement les quatre récits ethnographiques. Délaissant la revendication ou la résistance organisée, le politique s’incarne dans des gestes qui engagent les corps et dans des performances sensibles qui valorisent la transformation individuelle. Ces gestes esthétiques dispersés évoluent en acte politique lorsque le moment créatif opère une rupture dans l’ordre convenu des choses tandis que l’accumulation d’actes politiques dans un récit collectif constitue l’action politique proprement dite. Saisir la singularité politique de tels gestes esthétiques qui se déploient en dehors d’un cadre institutionnalisé nécessite une ethnographie attentive de la jeunesse, des lieux et des espaces urbains qu’elle investit au quotidien. L’accès aux mondes urbains de la jeunesse montréalaise implique de construire sur le terrain des relations de confiance ainsi qu’un partenariat épistémique avec les jeunes intéressés à la recherche. En plus de cultiver le recours à l’ensemble de ses sens, la réceptivité et l’intelligence émotionnelle, une pluralité de méthodes, variables selon les terrains, est mobilisée : observation participante, recherche participative, parcours commentés, entretiens classiques, production de cartes mentales, outils technologiques et multimédias…
Le chapitre I s’emploie à montrer la manière dont l’ambiance politico-sensible de la ville et les subjectivités contemporaines ont été façonnées par la contre-culture urbaine des années 1960 et 1970. Celle-ci a inauguré des relations changeantes au temps comme à l’espace. Le temps a cessé d’être marqué par la flèche du progrès : il est devenu plus fragmenté, davantage inscrit dans l’« ici et maintenant ». L’espace s’est décloisonné et les expériences de subordination, d’exclusion socio-spatiale, de dépossession et d’oppression vécues alors par les minorités montréalaises sont pensées à partir des théories des pays du tiers-monde et des mouvements de décolonisation. Montréal s’inscrit dans les mouvements de jeunesse interconnectés qui, dans différentes villes du monde, recourent à un même répertoire de marches, de sit-in, bed-in, die-in et autres performances où les corps sont mis en scène dans l’espace public urbain. Les enjeux contemporains s’alimentent à cette culture politique et à la mémoire de ces luttes passées qui ont transformé les rationalités, les modes d’action et les subjectivités politiques.
Le chapitre II nous fait circuler dans les mondes politiques de la jeunesse qui vit dans les quartiers de Saint-Michel et de la Petite Bourgogne, et qui est confrontée aux techniques du profilage racialisé des politiques publiques et à la stigmatisation médiatique. Les jeunes y sont saisis à travers un projet de recherche qui leur permet, à travers des médiations artistiques et esthétiques, de se réapproprier leurs propres représentations de leur quartier, objet de stéréotypes fondés sur la couleur de peau des habitants et/ou attachés au lieu. À l’aide d’outils tels que l’écriture, le chant, le dessin, la production de vidéos, les jeunes extériorisent leurs peurs, leurs colères et leur sentiment d’injustice tout en exprimant les relations affectives qui les lient au quartier et le font exister au-delà d’une couverture médiatique qui le discrédite. Leur agentivité politique s’exprime notamment dans ces performances artistiques sollicitées par un projet de recherche qui entre en résonance avec celui qui a débouché sur l’ouvrage collectif Jeunes de quartier. Le pouvoir des mots[2].
Le chapitre III est centré sur le seul événement explicitement politique du livre, celui du « printemps érable » de 2012, mobilisation contre l’augmentation des frais d’inscription à l’université. Ce terrain a joué un rôle central dans l’orientation problématique de l’ouvrage : interrogés sur les causes de leur engagement, les jeunes mentionnent plutôt les formes prises par celui-ci et les moments prégnants les ayant aspirés dans le mouvement. Le discours attendu sur les raisons de l’engagement (parcours de politisation, valeurs défendues, revendications…) s’efface devant l’évocation de l’indignation et de l’espoir, de l’amitié, du plaisir, de la réalisation de soi, de l’amertume suscitée par les tensions entre étudiants mobilisés et ceux qui ne l’étaient pas, ou encore de la crainte de la police. Les concerts de casseroles, le carré rouge ou la peluche Anarchopanda dégagent, chez les jeunes engagés, une forte charge affective. Le « printemps érable » est décrit comme ayant ouvert de nouveaux espaces d’action politique à travers la multiplicité des rencontres, l’intensification des expériences réalisées, l’exploration, la spontanéité ou la provocation…
Le chapitre IV nous fait entrer dans le monde politique de la City Farm School rattachée à l’université Concordia. Cet espace de formation à l’agriculture urbaine communautaire valorise des apprentissages pratiques centrés sur la production et la distribution d’aliments biologiques. Plus que les précédents, ce chapitre se montre attentif aux capacités d’agentivité distribuée entre humains et non-humains (sols, semences, végétaux, micro-organismes…) qui coopèrent en vue de produire des espaces urbains plus fertiles et biodiversifiés. À travers un engagement centré sur des pratiques concrètes de culture et de production, ici et maintenant, offrant plaisir, spontanéité, créativité et de fortes énergies affectives avec les plantes, la terre et les organismes vivants qui la peuplent, ces jeunes s’emploient à rendre visible leur dépendance vis-à-vis du système agricole mondial et des circuits alimentaires de l’économie marchande. L’analyse rend compte avec beaucoup de finesse des connaissances expérientielles qui s’acquièrent et se transmettent, des affects qui circulent et des capacités d’attraction et de répulsion qu’exercent certains acteurs non-humains sur les humains qui produisent ensemble un monde plus écoresponsable.
Le cinquième et dernier chapitre suit plusieurs preneurs de risques volontaires. Faire du skate sur les trottoirs, pratiquer la slackline dans un parc urbain, escalader des bâtiments pour y dérouler une banderole, taguer ou graffer des édifices interdits d’accès, récupérer dans les poubelles des aliments encore comestibles participent tous d’une expérience sensible de déchiffrage de la ville. Ces pratiques ont également en commun une prise de risques physique, sociale, juridique, faite de transgression et de provocation qui procurent à ceux et celles qui les expérimentent une étreinte de la peur associée à un sentiment de maîtrise et de réalisation de soi. Le geste provocateur est analysé comme une modalité esthétique du pouvoir dès lors qu’il révèle les incohérences et les limites des normes sociales. Souvent diffus, disséminé, invisibilisé, ce même geste s’affirme plus ouvertement comme acte politique lorsqu’il se voit confirmé par une ordonnance municipale (cas de la slackline), lorsque plusieurs centaines de skateurs se rassemblent pour le Gold Skate Day, lorsque des preneurs de risques s’affrontent avec la police ou lorsqu’il est soutenu par un discours contre le consumérisme (cas du dumspter diving).
À partir d’une ethnographie plurielle et richement documentée, l’ouvrage apporte un éclairage bienvenu sur la manière dont les cultures urbaines contemporaines interrogent la définition des processus politiques. En appréhendant l’action politique par le bas, à travers des gestes esthétiques souvent diffus et fragmentés qui ne se donnent pas spontanément à lire comme politiques mais le deviennent dans leur accumulation et dans les propos et les actes qui parfois les accompagnent, les autrices rendent pleinement justice aux engagements des jeunes participants aux différentes recherches. Elles mettent en valeur leurs capacités d’action, la centralité esthétique de ces actions et les ressorts politiques qui les animent et s’y donnent à voir lorsque la focale est correctement positionnée. Ce faisant, les autrices nous contraignent à changer de regard tant sur le politique que sur la jeunesse d’aujourd’hui et c’est peu dire qu’un tel changement de regard, sans être entièrement nouveau, demeure salutaire. Pour autant, l’ouvrage offre plusieurs points de discussion.
Le premier concerne la centralité grandissante de l’action politique esthétique – sous-titre de l’ouvrage – dans un monde urbain en réseaux marqué par des inégalités croissantes et l’affaiblissement des États-nations. Si cette grille de lecture a le mérite de reconnaître le caractère politique d’un ensemble d’investissements jusque-là négligés, elle tend à faire oublier que le répertoire d’action politique de l’ancien monde présentait également – et présente encore lorsqu’il est mobilisé – une puissante dimension esthétique. C’est par exemple le cas de la manifestation et de ses cortèges, banderoles, chants, slogans qui, en rendant manifeste un problème, convoquent, depuis le XIXe siècle, expressivité et émotions dans la rue ; c’est encore le cas de la grève lorsqu’elle investit et se réapproprie l’espace de travail en le détournant de sa fonction première pour en faire un espace politique… Plutôt que la nier, on aurait aimé que les autrices prennent davantage en considération la dimension esthétique des modes d’action politique associés à l’État-nation et s’attachent à en souligner les différences avec les formes contemporaines observées.
Le deuxième point de discussion a trait au recours à la notion de mondes qui donne son titre à l’ouvrage. Les autrices, qui se réfèrent explicitement aux mondes de l’art d’Howard Becker[3], mobilisent une conception de la notion de mondes plus lâche et poreuse (p. 40) que Becker. Elles soulignent l’importance des interactions élargies aux espaces et objets de la ville ainsi qu’aux non-humains, là où Becker s’attache aux interactions entre une diversité d’acteurs (artistes, professionnels responsables de la production, de la diffusion ou de la médiation, publics) dont la coopération est nécessaire pour faire exister les œuvres d’art. Dans les mondes urbains de la jeunesse, la coopération apparaît très inégale : dense et collaborative dans le monde de l’agriculture urbaine où humains et non-humains participent ensemble à la production d’un monde plus écoresponsable, solidaire chez les étudiants engagés dans le mouvement du « printemps érable », elle est beaucoup plus incertaine chez les jeunes racisés des quartiers Saint-Michel et de la Petite Bourgogne et clairement inexistante chez les différents preneurs de risques volontaires dont le rapprochement est un pur effet de l’enquête. Chez Becker, les mondes de l’art sont des sous-espaces sociaux relativement autonomes les uns des autres qui obéissent à une logique de fonctionnement commune que le sociologue s’emploie à dégager. Le livre recensé hésite, lui, entre deux perspectives : la première identifie, comme chez Becker, une matrice commune – celle d’une reconfiguration des processus politiques à travers des formes d’engagement esthétique – tandis que la seconde suggère des mondes urbains de la jeunesse empiriquement reliés entre eux. Au début de l’introduction, ces derniers sont ainsi qualifiés de « très différents », mais néanmoins « interconnectés » (p. 5) et, plus loin, les autrices évoquent un espace de communalité partagé (p. 41). Dès lors que le propos est une ethnographie des processus politiques, la question de savoir si les différents mondes urbains de la jeunesse font monde commun prend tout son sens. À l’exception du cas isolé du jeune skateur preneur de risques déjà rencontré lors du « printemps érable », les mondes urbains de la jeunesse apparaissent relativement étanches les uns aux autres et certaines différences sociales et raciales difficiles à dépasser. Les enquêtes ayant été conduites de manière autonome, dans des temporalités proches, mais non coordonnées, cette question n’a pu être prise à bras le corps ni même étudiée, ce qui est dommage.
Certains lecteurs et lectrices ne manqueront également pas d’être rebutés par la très longue introduction de cinquante-quatre pages. Le cadrage théorique extrêmement nourri, quasi virtuose, qui s’y trouve proposé, présente un aspect par trop surplombant qui a tendance à écraser d’emblée les terrains empiriques développés par la suite. Il y a un paradoxe à se proposer de saisir la politique par le bas, à se rendre disponible et attentif à un ensemble de gestes invisibilisés et à les étouffer quelque peu sous une trame théorique ardue, là où une introduction courte autour d’une problématique resserrée aurait indéniablement tenu les lecteurs en alerte et favorisé leur accès aux différents terrains. Pourquoi ne pas avoir basculé la discussion théorique dans un chapitre final ? Celle-ci n’aurait rien perdu à faire dialoguer en bout de course les éléments empiriques issus des ethnographies avec les nombreux travaux philosophiques mobilisés. Il serait dommage que le choix réalisé décourage les lecteurs.
[1] Le laboratoire Vespa est rattaché à l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) et au réseau de l’université du Québec.
[2] Collectif Pop-part, coordonné par Marie-Hélène Bacqué et Jeanne Demoulin, 2021, Jeunes de quartier. Le pouvoir des mots, C&F éditions (https://cfeditions.com/jdq/, consulté le 22 novembre 2023).
[3] Howard S. Becker, 1988, Les mondes de l’art, Paris, Flammarion.

