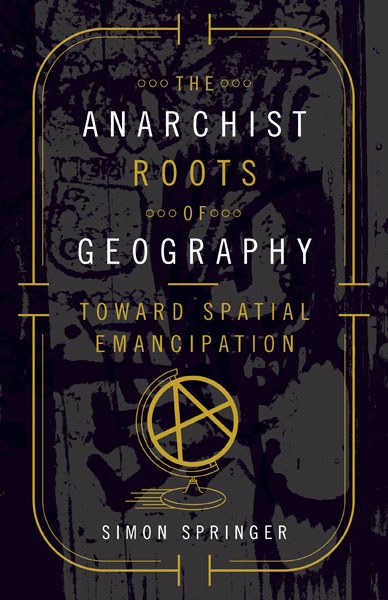
Simon Springer
The Anarchist Roots of Geography. Toward Spatial Emancipation
University of Minnesota Press, 2016, 229 p. | commenté par : Grégory Busquet
L’ouvrage de Simon Springer, sorti en 2016, nous replonge dans l’histoire intellectuelle et politique de la géographie humaine que l’auteur explore depuis de nombreuses années et dont il est devenu un spécialiste. Il revient ce faisant sur un pan et sur les origines de la géographie radicale – la géographie anarchiste – que l’épistémologie marxiste et ses héritages ont eu tendance à éclipser, notamment depuis la diffusion des travaux de David Harvey. À travers ce travail très théorique de mise à plat, on comprend rapidement la volonté, pour Simon Springer, de réhabiliter et de remettre à leur juste place les théories anarchistes du XIXe siècle dans le développement de la discipline. Ceci est rendu nécessaire, selon lui, par l’existence de systèmes de domination qui, quels qu’ils soient – étatiques, capitalistes, racistes, sexistes ou impérialistes –, ont tous des ressorts spatiaux. La géographie a donc toute sa place pour les analyser et les dénoncer (p. 4). Le second impératif réside dans le fait que la seconde moitié du XXe siècle et le début du XXIe siècle sont riches en pratiques spatiales à visées émancipatrices, qui tentent de dépasser ces dominations, et qui sont plus ou moins inspirées des idées libertaires, qu’il s’agisse des squats, du do it yourself, de réseaux d’activisme internationaux, des luttes pour l’espace public, de lieux autonomes, de communautés rurales autogérées, etc.
Dès la lecture du titre, on comprend cependant que l’ouvrage ne portera pas sur l’espace et sur les rapports de dominations et de hiérarchie dont il serait le support ou le produit, ni même sur les pratiques spatiales émancipatrices, mais sur la manière de faire ou de penser la géographie en anarchiste. L’auteur justifie lui-même cette entreprise en rejetant, dès l’introduction, ce qu’il considère être une injonction à l’empirisme, en tant que les pratiques spatiales ne peuvent être séparées de la théorisation dans la praxis révolutionnaire. Ce point est sujet à discussion mais cohérent avec le fil rouge de l’ouvrage qui part du principe que nos « pratiques quotidiennes » peuvent toutes (ou la plupart) relever d’« expressions géographiques particulières de l’anarchisme » (p. 16, ma traduction) et que la géographie a, plus que tout, aujourd’hui « besoin de théorie » (p. 16, ma traduction). La thèse principale du livre consiste donc à montrer que la géographie, historiquement et à l’heure actuelle, a autant besoin des théories anarchistes que celles-ci ont besoin de la géographie.
Après une longue introduction revenant sur les objectifs du livre, ainsi que sur les principales idées des penseurs et penseuses anarchistes du XIXe siècle, l’auteur aborde, dans le premier chapitre, ces origines anarchistes de la géographie humaine, à partir notamment du développement des idées anti-impérialistes et de celles des deux pères fondateurs de la géographie humaine : Élisée Reclus et Piotr Kropotkine. Nous sont notamment rappelées les bases de la philosophie anarchiste qui s’oppose au darwinisme social et à une évolution des sociétés humaines basée sur l’idée de compétition, compétition qui justifie les hiérarchies sociales et politiques, les inégalités et les dominations. L’idéal anarchiste oppose à cette compétition les concepts de solidarité, de coopération et d’entraide. Ces conceptions sont primordiales chez les géographes anarchistes qui ont permis le développement scientifique de la géographie humaine (Ferretti et Pelletier, 2015). Simon Springer décrit ensuite l’effacement de ces idées dans la discipline, puis leur réapparition dans les années 1970 avec l’émergence de la géographie radicale, avant d’évoquer un nouveau reflux, dû à la mainmise progressive du néomarxisme.
Le chapitre qui suit se présente comme un « manifeste pour une géographie anarchiste » (p. 17, ma traduction) en en posant les termes : ceux d’une géographie se donnant pour but d’« imaginer des alternatives » à l’État et au système capitaliste qui reposent sur la propriété, la domination, la hiérarchisation et la violence (p. 55).
La géographie anarchiste doit d’abord partir du « ici et maintenant » cher à la pensée libertaire, en s’attachant notamment à l’espace-temps de la vie quotidienne qui serait une ressource pour l’émancipation individuelle et collective. Ceci renvoie aux pratiques « préfiguratives » d’une société postcapitaliste et postétatique, et n’est bien sûr pas sans rappeler la « critique de la vie quotidienne » élaborée par le philosophe marxiste Henri Lefebvre dès les années 1940, et reprise par le mouvement situationniste quelques années plus tard avec la « construction de situations » dans l’espace et dans le temps (1958). Ce faisant, la géographie anarchiste ne doit pas pour autant perdre de vue ses critiques de l’État et de l’impérialisme.
Le troisième chapitre, en revenant sur les « racines radicales de la géographie », entre en discussion avec la géographie marxiste. C’est sûrement là l’intérêt majeur de cette entreprise de revisite de la géographie anarchiste. Simon Springer veut illustrer la thèse que, si les idées anarchistes et le marxisme se sont affrontés historiquement au sein du mouvement ouvrier, la discipline géographique est l’autre lieu de leur dispute. Le chapitre apparaît cependant plus explicatif sur la philosophie anarchiste et son opposition au marxisme que sur la place de la discipline géographique dans cette dispute. Les idées libertaires proposent quoiqu’il en soit aujourd’hui une autre voie, opposée au capitalisme néolibéral (impérialiste et inégalitaire pour les individus et les groupes dans l’espace) mais aussi au marxisme globalisant. L’anarchisme s’oppose par exemple à une utopie et à une attente du grand soir en lui opposant ce fameux « ici et maintenant », qui peut prendre la forme d’autogestions locales et/ou sectorielles, de politiques préfiguratives ou de « communes autogérées organisées en fédéralisme libre » (p. 71, ma traduction). L’action quotidienne insurrectionnelle et spatialisée (le fameux spontanéisme et l’insurrection permanente) s’oppose à la construction d’une révolution organisée par une avant-garde éclairée, pour la réalisation d’une société libérée des dominations et des inégalités. Il faut partir de l’« ici » et du « maintenant » de l’individu, des rapports sociaux et de la vie quotidienne dans l’espace, c’est-à-dire « nous changer nous-même pour changer le monde » selon le célèbre adage. À la différence du marxisme pour lequel la révolution est un moyen dans la perspective d’un but politique (le remplacement d’un type d’État par un autre avant son dépérissement), la révolution, pour les anarchistes, devient un mode de vie, une pratique quotidienne contre l’autorité et sans autorité, et dans laquelle on peut légitimement se poser la question du rôle de l’espace, de ses pratiques et représentations. L’« ici et maintenant » amène donc à s’intéresser à la vie quotidienne dans l’espace.
Le quatrième chapitre s’arrête enfin justement sur le rôle de l’espace dans le projet anarchiste en empruntant paradoxalement à des auteurs marxistes ou postmarxiste comme Henri Lefebvre, Doreen Massey, Chantal Mouffe, Antonio Negri ou le géographe Don Mitchell. C’est l’espace public qui est retenu comme devant servir de support pour l’émancipation face aux discriminations et oppressions de toutes sortes. L’auteur reprend à son compte le droit à la ville théorisé par Lefebvre et repris par le géographe Don Mitchell comme droit à la reconnaissance des groupes dans un espace public démocratique, inclusif et célébrant la différence, face à la reproduction de l’aliénation de la vie quotidienne, c’est-à-dire à l’opposé d’un espace public synonyme d’ordre, d’exclusion et de surveillance. Le logement et le voisinage, l’espace privé, pensés par les épistémologies féministes ou les situationnistes, ou encore les équipements de « normalisation » travaillés dans les années 1970 par le Cerfi foucaldien auraient pu compléter ce tableau. Mais le droit à la ville dans l’espace public, en tant qu’espace de la contestation du pouvoir, demeure pour l’auteur celui qui est porteur d’espoirs. Il s’agit de transformer l’espace pour aboutir à une démocratie radicale, non pas, encore une fois, en élaborant une utopie socio-spatiale, mais en y forgeant des solidarités, en sortant des logiques de souveraineté et d’autorité. Simon Springer en arrive toutefois dans le cinquième chapitre intitulé « anarchisme intégral » à la modélisation d’un système socio-spatial à laquelle une géographie anarchiste pourrait participer : il faut selon lui construire des « spatialités kaléidoscopiques » (p. 148, ma traduction) et une société rhizomatique (Deleuze et Guattari, 1980) organisée de manière décentralisée, ahiérarchique et anti-autoritaire. De telles spatialités permettraient des « connexions multiples entre entités autonomes » (ibid.), des solidarités volontaires, « libérées de la violence, des normes sociales prédéterminées et des catégories d’appartenance assignées » (ibid.). Pour imaginer cela, la géographie doit sortir des schémas de pensée impérialistes et liés à la domination et aux inégalités, d’où le salutaire retour aux sources de ce livre.
Le dernier chapitre revient sur la discussion avec la géographie marxiste et avec David Harvey qui, selon Simon Springer, n’arrivent pas à sortir de l’idée de la nécessité d’une autorité pour le changement socio-spatial tant attendu. Partant des théories de l’écologiste libertaire américain Murray Bookchin sur le municipalisme libertaire et l’écologie sociale, il oppose encore une fois au marxisme les pratiques préfiguratives au niveau local. Simon Springer en vient donc à une réflexion sur l’épineuse question des échelles. L’anarchie comme mode de vie nécessite une réflexion sur les échelles pour la production de spatialités alternatives adaptées à ces préfigurations. Il s’agit de favoriser les pratiques locales face aux hiérarchies scalaires et descendantes. Ceci n’est pas sans évoquer les liens dialectiques entre « ordre proche » et « ordre lointain » dont le dépassement est rendu possible par l’appropriation, l’« habiter » et la vie quotidienne dans la théorie d’Henri Lefebvre (1968). Les échelles de temps ne sont pas non plus absentes de ces réflexions : l’immédiateté du « ici et maintenant » s’oppose au futur hypothétique de l’utopie révolutionnaire du marxisme orthodoxe.
L’ouvrage se termine par cette critique des échelles qui encourageraient une pensée hiérachisante, en « dépolitisant » la pensée géographique et la pensée sur l’espace en général. L’horizontalité et le rhizome sont ainsi destinés à remplacer la hiérarchie et ses échelles, dans un kaléidoscope de zones d’autonomie, contre les dominations et leurs expressions spatiales. L’horizon d’une géographie réellement libertaire ne serait donc ni hiérarchique, ni vertical, ni scalaire, mais « relationnel » entre individus et réseaux locaux. C’est la seule condition spatiale à la transformation des modes de vie.
Au final, cet ouvrage apparaît nécessaire du point de vue épistémologique et du point de vue académique, notamment parce qu’il permet de relier les théories anarchistes aux géographies féministes, postcoloniales, décoloniales, tout en nous invitant à émanciper notre pensée spatiale en la libérant de tout ce qui relève des dominations multiples, en adoptant un point de vue intersectionnel revendiqué. Si l’auteur refuse de « s’excuser » (p. 16, ma traduction) pour la dimension théorique de son ouvrage, il est dommage que son message en devienne parfois un peu abstrait et parfois répétitif. Si les pratiques préfiguratives consistent à partir de l’existant et de l’« ici et maintenant », on regrettera non pas tant ce refus de l’empirisme (le propos de l’ouvrage est autre) mais un minimum de description de ces pratiques – ou seulement de quelques-unes – sur lesquelles pourraient s’appuyer l’argument. Ces pratiques émancipatrices sont simplement souvent évoquées sous forme de listes, sans jamais que ne soient explicités ou détaillés leurs rapports à l’espace et aux spatialités. L’espace public lui-même, présenté comme l’espace privilégié de l’émancipation, est traité de manière abstraite, hors de toute pratique et représentation concrètes. Les emprunts de théories issues des terrains d’autres auteurs offrent finalement l’avantage de faire de cet ouvrage une sorte de manuel de géographie anarchiste, mais toutefois un peu vidé d’exemples concrets qui donneraient du poids au propos général.
Le titre de la récente traduction française au Québec du livre « Pour une géographie anarchiste[1] » annonce sûrement mieux, à ce propos, les deux objectifs principaux du livre : la légitimation et la remise en lumière des ressorts anarchistes de la pensée géographique, et l’appel à une émancipation des géographes face à l’alternative marxisme/libéralisme.
Bibliographie
Deleuze Gilles, Guattari Felix, 1980, Capitalisme et schizophrénie, tome 2, Milles plateaux, Paris, Minuit.
Internationale situationniste, no 1, 1958, in Internationale situationniste 1958-1969, 1997, Paris, Librairie Arthème Fayard, p. 3-32.
Ferretti Fédérico, Pelletier Philippe, 2015, « Spatialités et rapports de domination dans l’œuvre des géographe anarchistes. Reclus, Kropotkine et Metchnikoff », dans Clerval Anne, Fleury Antoine, Rebotier Julien, Weber Serge (dir.), Espace et rapports de domination, Rennes, Presses universitaires de Rennes, p. 23-34.
Lefebvre Henri, 1947, Critique de la vie quotidienne, tome 1, Paris, L’Arche.
Lefebvre Henri, 1962, Critique de la vie quotidienne, tome 2, Paris, L’Arche.
Lefebvre Henri, 1968, Le droit à la ville, Paris, Anthropos.
[1] Springer Simon, 2018, Pour une géographie anarchiste, traduit de l’anglais par Nicolas Calvé, Lux Editeur, coll. Instinct de liberté.

